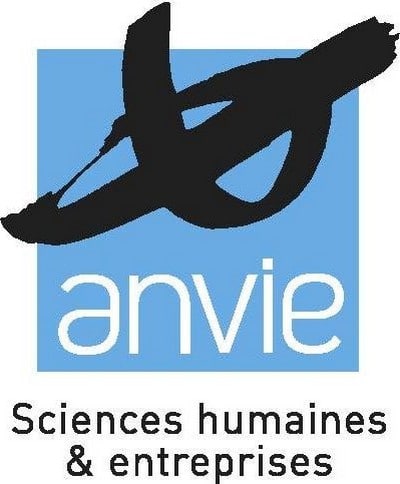CORTE (CORSE) LES 29 & 30 SEPTEMBRE 2011
En partenariat avec l’ACSé, l’AFPA, l’AGRH, l’IAS, l’AFMD, l’ANDRH, l’ADERSE, l’ARACT Corse, le CRAII Corse, La Charte de la Diversité, IMS-Entreprendre pour la Cité, Entreprise & Carrières, Management & Avenir et Diversity Conseil.
DIVERSITÉ(S) : APPROCHES INTERNATIONALES
PROGRAMME PROVISOIRE AU 13 SEPTEMBRE 2011
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2011
8h00 à 9h00 ACCUEIL ET PETIT DEJEUNER
9h00 à 9H30 Ouverture par Jean Marc CERMOLACCE, Président du CA de l’IAE de Corse, Jean-Marie FURT, administrateur provisoire de l’IAE de Corse, les professeurs Jacques ORSONI, Président « Les Défis de la Diversité », Zahir YANAT, Vice-président de l’AGRH et de l’ADERSE, Jean-Marie PERETTI, Président de l’IAS et Antoine FERACCI,
Président CPIE A Rinascita.
9h30 à 11h00 TABLE RONDE I : Diversité (s) : convergences internationales
Présidée par le professeur Zeineb BEN AMMAR MAMLOUK, Université de Tunis,
Animée par Jean-Marie PERETTI, professeur IAE de Corse
Avec Frédérique POGGI, directrice Diversité Groupe ACCOR, Raphael DOUTREBENTE, DRH et Organisation, Groupe MONIER, Marie-Paule ISTRIA, directrice, MPI, , Iula SALA, Responsable diversité, ORSE, Benjamin BLAVIER, Délégué général de Passeport Avenir et Elie BASBOUS, Professeur, Université libanaise, Beyrouth.
11h00 à 11h30 – PAUSE CAFE
11h30 à 12h30 Remise des TROPHEES Groupe AFPA “Politiques de formation innovante en matière de lutte contre les discriminations”
par Jean-Luc VERGNE, Président AFPA, Président ANACT, Jacques ORSONI, Président “les defis de la diversité” , Jean-Marie PERETTI, Président de l’IAS et Marie Christine GABILLAUD-WOLF, Déléguée générale AFMD.
Présentation de leur “politique et pratiques de formation pour développer l’égalité des chances” par les responsables diversité des entreprises et organisation lauréates
12h30 à 14h00 – DEJEUNER
14h00 à 15h15 TABLE RONDE II: Mesurer et évaluer les résultats d’une politique de Diversité.
Présidée Jean Luc VERGNE, président AFPA.
Animée par professeur Luc BOYER, directeur “Management & Avenir”
Avec Jean-Michel MONNOT, Vice président Diversity & Inclusion, groupe SODEXO, Kag SANOUSSI , Secrétaire Général de la Charte de la Diversité, Alain GAVAND, A compétence égale, Gérard LEFRANC, Responsable mission insertion, groupe THALES. Marie Christine BARJOLIN, BNP Paribas Cardif, Marie DELMONT, MPI-Conseil, Sabine LUNEL-SUZANNE, Responsable Développement des Compétences & Diversité, INEO-GDF-SUEZ, Dominique MASSONI, DRH et Communication, ARKEMA
15h15 à 15h30 PAUSE
15h30 à 16h45 TABLE RONDE III: Les approches internationales des politiques de diversité
Présidée par Hicham ZOUANAT (Président AGEF Maroc, DRH Centrale Laitière)
Animée par Alain LEMPEREUR, professeur, Université Brandeis, Boston, USA.
Avec Christian SANCHEZ, Directeur du développement social de LVMH, Yassine FOUDAD, (Président AAAS, Algérie), Laurence RECKFORD, chef de projet diversité, TOTAL, Laurent DEPOND, Vice Président Diversité groupe France Telecom, Catherine TRIPON, Porte parole de l’Autre Cercle, Natacha SEGUIN, Groupe ALPHA et Frédérique ALEXANDRE BAILLY, ESCP Europe.
16h45 à 18h15 Cérémonie de remise des “6es TROPHEES DE LA DIVERSITE” de Diversity conseil en partenariat avec IMS-Entreprendre pour la Cité, le secrétariat de “La Charte de la Diversité” et l’association “les défis de la Diversité”, animée par Anne SAÜT Diversity Conseil :
– Présentation des actions menées par les entreprises lauréates pour leur “Politique globale de diversité”
– Remise des trophées par les membres du Jury et les représentants du Secrétariat de la Charte, l’IMS, l’IAS, l’AGRH, l’ANDRH, le MEDEF, la CGPME, l’ADERSE, l’AFMD et Diversity Conseil.
19h30 DINER TRADITIONNEL DANS UNE FERME-AUBERGE:
« U CENTU CHIAVE ».
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2011
8h30 ACCUEIL ET PETIT DEJEUNER
9h00 à 10h30 : Symposium et Ateliers
Atelier 1 : Marketing et Diversité I
Présidé par Jean-Claude ANDREANI, ESCP Europe et Nehmé AZOURY, USEK, Liban
Animé par Jacques ORSONI, IAE de Corse
Avec Jean François TRINQUECOSTE (Université de Bordeaux IV) et Valentina KIROVA (ESC La Rochelle), Françoise ANDREANI, ESCP Europe, Jean Louis MOULINS (Université de la Méditerranée) et Jean François TOTI (IAE d’Aix), Thérèse ALBERTINI, Delphine BERENI et Thierry FABIANI (Université de Corse)
Atelier 2 : Diversité et Genre
Co présidé par Stephan GRÖSCHL, ESSEC Business School et Catherine TRIPON, Porte Parole de l’Autre Cercle
Animé par Anne Marie FRAY, ESCEM
Avec Christina CONSTANTINIDIS ((Centre de recherche Henri TUDOR, Luxembourg), Rey DANG (Université d’Orléans), Désiré LOTH (Université de Grenoble 3), Marie José SCOTTO (IPAG), Hervé TIFFON (IPAG), André BOYER (IAE de Nice), Noura SALMAN (Université de Liège), Manal El ABBOUBI (ESC La Rochelle), Sana GUERFEL-HENDA (Groupe Sup de Co Amiens) et Françoise de BRY, PROPEDIA, Groupe IGS, Cercle d’éthique des affaires, Laurent DEPOND, France Telecom Orange.
Atelier 4 : Diversité des âges
Co Présidé par Eric VATTEVILLE, Université de Rouen et Dominique BALLOT, consultant.
Animé par Delphine VAN HOOREBEKE, IAE de Toulon
Avec Julie CHRISTIN- MOULINS (EMD Marseille) Diane-Gabrielle TREMBLAY(UQAM), Abdelkarim YAOU (IAE de Corse), Jean Marie ESTEVE, SOLATRAG, Gwenaëlle POILBOT-ROCABOY et Natacha PIJOAN (Université de Rennes 1), Bruce ROCH, Vice Président AFMD, directeur RSE, ADECCO
Symposium 1 : Egalité des chances et insertion professionnelle
Co-présidé par Hervé BELMONT, DIRECCTE Corse et Dany BERGEOT, directeur régional Pôle Emploi.
Animé par Pascal OBERTI, Université de Corse.
Avec Claudine FILIPPI, DRJCS-ACSé, Alain GAVAND, A compétences égales, Dominique MERLINGHI, Atlas Insertion, Pierre-Jean RUBINI, FALEP Corse-du-Sud, Nathalie ROYER, Ecole de la 2e chance, Catherine MARTINETTI, A Mossa, Cécile BIANCHI, Maison de l’emploi d’Ajaccio, Ange-François FILIPPI, Greta Corse-du-Sud, Claire
CICCOLINI, Boutique de Gestion, Jacqueline MUFFRAGGI, Association Culture et Solidarité, Didier GRASSI, IRA Bastia, Christophe STORAI, Directeur du CFA – Université de Corse, François GABRIELLI, Président de la Chambre Régionale des Métiers de Corse, Dominique GIOVANANGELI, Président de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, Jacques VINCENTELLI, GRETA Corse du Sud, Corine NOBILI, DGASEP Mairie D’Ajaccio, Maryse DROFF, Responsable égalité des chances, Groupe France Telecom
10h30 à 12h00 TABLE RONDE IV : “Le Label Diversité: Bilan (après trois ans) et perspective en France et en Europe”
Présidée par Bruce ROCH, Vice Président AFMD, directeur RSE, ADECCO
Animée par Emmanuel FRANCK, Entreprise & Carrières
Avec Antoine MAURI, Management de la Diversité, La Poste, Thierry GEOFFROY, Chargé de mission, AFNOR certification, Patrick AUBERT, chef du bureau de l’intégration professionnelle, direction de l’intégration et de la citoyenneté, ministère de l’intérieur, Vincent BAHOLET, Délégué Général de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), Daniel MERILLOU, ANDRH, Cristina LUNGHI, Présidente d’Arborus, Hélène LOUBEYRE, Responsable Projets Diversité, IMS Entreprendre pour la Cité.
12h00 à 13h30 DEJEUNER
13h30 à 14h45 Symposiums et Ateliers
Atelier 5 : Diversité, carrière et apprentissage
Coprésidé par Jean-Michel MONNOT, Vice Président Group Diversity &
Inclusion, SODEXO, & Philippe NEGRONI, ARACT de Corse
Animé par Alain GAVAND, Président d’A Compétences Egales.
Avec Nathalie PHOEBE-MONTARGOT (Université de Cergy-Pontoise), et Michael PICHAT (Université Paris 8), Patrick MICHELETTI (Euromed Management Marseille). Audrey BECUWE (Université de LIMOGES), Isabelle Laurent MERLE (Université de Limoges), Nathalie BERTIN BOUSSU (Groupe Sup de Co Amiens), Laëtitia CZAPSKI (Grenoble Ecole de Management) et Anissa DJABI (Université Paris-Est, FACE) et Benjamin BLAVIER, Délégué général de Passeport Avenir
Atelier 6 : Diversité : visions, expériences et approches internationales
Coprésidé par Fernando CUEVAS, ESC PAU et Alexandre GUILLARD, CNP Assurances
Animé par Zeineb BEN AMMAR, Université de Tunis.
Avec Désiré LOTH (Université de Grenoble 3), Nicolas GHANTY (Université Paul
Sabatier Toulouse), Alain Pekar LEMPEREUR (Université de Brandeis), Marie Giuseppina BRUNA (Université Paris-Dauphine), Alain AKANNI (Université de Dakar), Jean Marie ESTEVE (SOLATRAG), Stéphane
LEYMARIE, Pascal TISSERANT et Sébastien
ARCAND (Université de Metz).
Atelier 7 : Recruter et gérer les compétences sans discrimination. Evolution
des compétences Cadres en Europe
Coprésidé par Khalid HAMDANI, Institut Ethique & Diversité et Sana
GUERFEL-HENDA (Groupe Sup de Co Amiens)
Animé par Alain GAVAND, A compétences égales Avec Jean-Yves MATZ, consultant
APEC, Dany BERGEOT, Pôle Emploi, Marie Paule ISTRIA, MPI Conseil.
Symposium 2 : Egalité des chances, lien social et politique de la
ville
Co-présidé par Claudine FILIPPI, DRJCS-ACSé & Christian SANCHEZ,
Directeur du développement social de LVMH,
Animé par Patrice TERRAMORSI, Université de Corse.
Avec Philippe TEJEDOR, Direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations de Haute-Corse, Jean-Louis ARIBAUD, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des population de Corse du Sud, François PIERI, Adjoint au
Maire d’Ajaccio en charge de la politique de la ville et de la jeunesse, Emmanuelle CAUSSE, DGASEP Mairie D’Ajaccio, Isabelle AUBERT, Mairie de Bastia, Marie Josée ANDREUCCI, CRAII.
14h45 à 15h00 PAUSE CAFE
15h00 à 16h15 Symposium et Ateliers
Atelier 8 : Mesurer la diversité : les outils de diagnostic et
d’évaluation
Coprésidé par Marc VALAX, IAE de Lyon et Vincent MATTEI, Recrutement et
mobilité, THALES
Animé par Soufyane FRIMOUSSE, IAE de Corse
Avec Natacha SEGUIN, Groupe ALPHA, Abderrahman JAHMANE, IAE de Lille, Zahir
YANAT (BEM), Odile FARRET (Crédit Agricole Aquitaine), Fernando CUEVAS, ESC PAU, et Benjamin
BLAVIER, Délégué général de Passeport Avenir
Atelier 9 : Ethique, RSE et diversité
Coprésidé par Corinne FORASACCO, Vice Présidente, Essec Alumni et Françoise
De BRY, PROPEDIA, groupe IGS et Cercle Ethique des affaires.
Animé par Erick LEROUX, Université de Paris XIII
Avec Khalid HAMDANI, Institut Ethique & Diversité, Mantiaba COULIBALY,
Groupe SUP-CO Amiens, François GOXE (Université Paris-Dauphine), Jean PERSON (.Université d’Orléans.), Laurent SERPAGGI, Université de Corse
Atelier 10 : Diversité et croyances
Coprésidé par Iulia SALA (Observatoire de la responsabilité sociétale des
entreprises, ORSE) et Roger-Pierre
HERMONT Université de Paris XII & IAS.
Animé par Alain PEKAR LEMPEREUR (Université de BRANDEIS).
Avec Eric VATTEVILLE, Université de ROUEN, Martine BRASSEUR (Université
Paris DESCARTES), Hicham BENAISSA (CNRS-EPHE, FACE).
Symposium 3 : Egalité des chances et prévention
Présidé par : Co-présidé par Claudine FILIPPI, DRJCS-ACSé & Ludovic
MARTEL, Université de Corse.
Animé par Danièle MAOUDJ, écrivain.
Avec Laurent MEGE, Collectif antiraciste Avà Basta, Krimau EL MAJOUTI,
Direction Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale, Patricia JACQUES, Conseil départemental de l’accès au droit de Corse-du-Sud (CDAD 2A), Bénédicte SIMON, Association CORSAVEM, Jacques
VINCENTELLI, GRETA Corse du Sud, Sébastien FREMONT, GRETA Haute-Corse, Marie PERETTI, EHESS, Marie Josée ANDREUCCI, CRAII et Jacqueline MUFFRAGGI, Association Culture et Solidarité.
16h30 à 17h30 : TABLE RONDE V : “Politiques et acteurs de l’égalité des
chances”
Co-présidée par Claudine FILIPPI, DRJCS-ACSé et Jacques ORSONI, IAE de
Corse
Animée par Vannina BERNARD-LEONI, Fondation de l’Université de
Corse.
Avec Simon RENUCCI, Député-Maire d’Ajaccio (à confirmer), Émile ZUCCARELLI,
Maire de Bastia (à confirmer), Joël PAIN, Directeur Général de PlaNet Finance, Dominique GIOVANANGELI, Président de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, Hervé BELMONT,
DIRECCTE Corse, Dany BERGEOT, directeur régional Pôle Emploi. Marie-Ange BIASINI-MORICONI, Déléguée du préfet de Corse-du-Sud, Marie-Ange SUSINI, Délégué régionale aux Droits des Femmes, Jean
ALESSANDRI, FALEP 2A,
17h30 à 17h45 Synthèse par Gwenaëlle POILBOT-ROCABOY
17h45 à 18h00 Clôture des « Septièmes rencontres de la Diversité » par les
professeurs
Jacques ORSONI et Jean Marie PERETTI.
20h00
BUFFET DINATOIRE ET ANIMATION POLYPHONIQUE
Les partenaires des septièmes rencontres internationales de la
diversité
La CPIE A Rinascita, L’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des changes
– ACSé, l’Association francophone de gestion des ressources humaines – AGRH, l’Association pour le Développement de l’Enseignement et de la Recherche sur la
Responsabilité Sociale de l’Entreprise – ADERSE, l’Institut International de l’Audit Social – IAS, l’Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines – ANDRH, l’’Association Française des Managers de la Diversité – AFMD, l’Association Française pour la Formation Professionnelle pour Adultes
– AFPA, l’Association Régionales pour l’Amélioration des Conditions de Travail de
Corse – ARACT de Corse – l’ORSE, Observatoire
de la responsabilité sociale de l’entreprise, le CRAII Corse, le secrétariat de la Charte de la Diversité, IMS-Entreprendre pour la Cité, Entreprise & Carrières,
Management & Avenir, Diversity Conseil.
Les participants des septièmes rencontres internationales de la
diversité
Acteurs nationaux et internationaux
A compétence égale, ADECCO, AFNOR certification, Agence pour l’Emploi des
Cadres – APEC, Arborus, Arkema, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Aquitaine, Essec Alumni, la CGPME, Fondation Agir Contre l’Exclusion, FT-ORANGE, Groupe ACCOR, Groupe ALPHA,
Groupe SODEXO, IFME, INEO-GDF-SUEZ, Institut Ethique & Diversité, l’ORSE, LVMH, MPI Conseil, THALES, TOTAL, Cercle Ethique des affaires.
Acteurs régionaux et locaux
Association A Mossa, Association CORSAVEM, Association Culture et
Solidarité, Atlas Insertion, Boutique de Gestion, Conseil départemental de l’accès au droit de Corse-du-Sud (CDAD 2A), Centre Régional
d’appui aux Acteurs de l’Insertion et de l’Intégration, CFA – Université de
Corse, Chambre Régionale des Métiers de Corse, Collectif antiraciste Avà Basta, DIRECCTE Corse, Ecole de la 2e chance de Corse, FALEP Corse-du-Sud, Greta Corse-du-Sud, Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire de Corse, Déléguation régionale au Droits des Femmes, FALEP Corse-du-Sud, GRETA 2A-2B, Maison de l’emploi d’Ajaccio, Pôle Emploi, Institut Régional
d’Administration de Bastia, Direction Régionale Jeunesse, sport et Cohésion Sociale – Corse, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
de Corse, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 2A-2B, Ville d’Ajaccio, Ville de Bastia, Universités et écoles de management
Bordeaux Ecole de Management, Centre de recherche Henri TUDOR, Luxembourg, Ecoles des hautes études en sciences sociales –EHESS, ESC La Rochelle, ESC PAU, ESCP Europe, ESSEC Business School, Euromed Management Marseille, Grenoble Ecole de Management, Groupe Sup de Co Amiens, IAE d’Aix, IAE de Lille, IAE de Nice, IPAG, PROPEDIA (Groupe IGS), Université d’Orléans, Université de Bordeaux IV, Université de Brandeis (USA) Université de Cergy-Pontoise, Université de Corse, Université de Dakar, Sénégal, Université de Grenoble 3, Université de la Méditerranée, Université de Liège, Belgique, Université de Limoges, Université libanaise (Beyrouth), Université de Lyon III, Université de Metz, Université de Paris XII, Université de Paris XIII, Université de Rennes 1, Université de Rouen, Université de Tunis, Tunisie, Université Paris 8, Université Paris DESCARTES, Université Paris-Dauphine, Université Paul Sabatier Toulouse, UQAM, Canada.