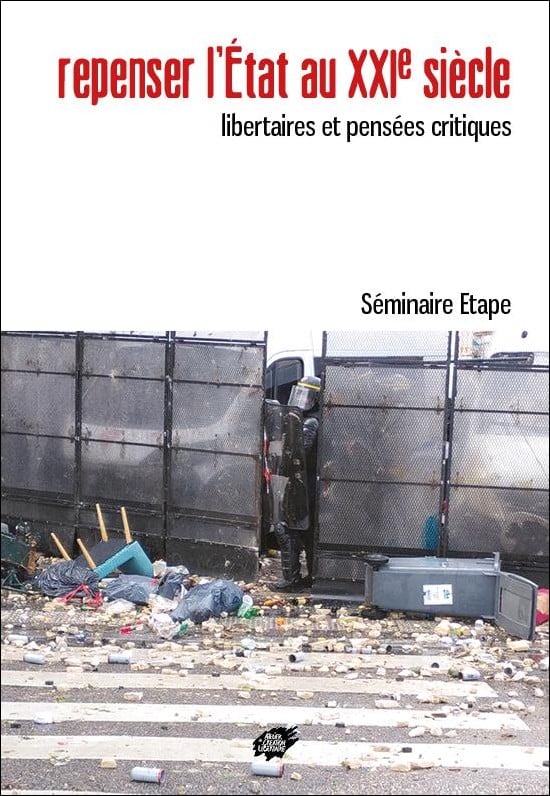Les Rendez-vous du Management de Marrakech (RMM) – deuxième édition – se sont tenus du 11 au 13 décembre 2024. Ils ont réuni chercheurs, professionnels et décideurs autour des enjeux de l’intelligence artificielle (IA) pour les organisations. Ce rendez-vous – permis grâce au soutien de l’université Hassan 1er et HEEC Marrrakech, et avec le concours important du Groupe Oliviers Santé – a ainsi marqué un tournant dans la réflexion sur l’impact de l’IA dans le monde des organisations au Maroc et à l’international. La Revue des Sciences de Gestion, partenaire depuis la première édition et présente tout au long de l’événement, a été soutenue à cette occasion par la venue depuis Paris des représentants de l’Istec Business School et de la revue Management & Sciences Sociales.
Les Rendez-vous du Management de Marrakech 2025
seront intégrés au
Sommet francophone du Management organisé
– du 10 au 12 décembre 2025 –
par La Revue des Sciences de Gestion
à l’occasion de son 60e anniversaire (1965-2025)Cela comprendra deux temps forts de recherche, de présentations orales et de publications selon des modalités qui seront précisées :
– Travailler plus, travailler mieux ou travailler autrement ?
– La démocratie en santé qui sera ainsi le 3e colloque international organisé par LaRSG et la chaire
« Gestion des services de santé » du Cnam Paris.#LaRSG #mgmt2025
Les Rendez-vous du Management de Marrakech 2024 : lieu de formation
L’événement s’est ouvert par deux formations – sur toute la journée du 11 décembre – destinées à renforcer la capacité des doctorants.
- La première axée sur ce qui doit entrer en ligne de compte pour publier dans les grandes revues scientifiques. Elle a été animée, en matinée, par Yves Soulabail, secrétaire général de La Revue des Sciences de Gestion et enseignant-chercheur au sein de l’Istec Business School Paris. Délivrée dans les locaux d’HEEC Marrakech, elle a donné les clefs ouvrant les possibilités de publication dans les revues de gestion de premier plan en insistants sur les stratégies à mettre en œuvre.
À cette occasion, Yves Soulabail n’a pas manqué d’insister sur la nécessaire méfiance qu’il faut avoir envers de nombreuses revues prédatrices exploitant la méconnaissance des jeunes chercheurs. Il a d’ailleurs présenté les outils mis à disposition sur le site internet de la revue pour se protéger de ce phénomène.

- La seconde formation, dirigée par Adil Cherkaoui, professeur HDR et directeur adjoint du LAREDGO, a permis aux participants de mieux comprendre les techniques de constitution d’une revue de littérature systématique, outil essentiel pour tout chercheur en management.

RMM 2024 : une réflexion sur IA générative comme accélérateur de l’innovation et de la digitalisation des organisations
Les RMM 2024, dès le lendemain – le mercredi 12 décembre – remplissaient les 400 places de l’auditorium du théâtre Meydene, en plein cœur du nouveau quartier de « M Avenue Marrakech », à l’ouest de la ville. S’y retrouvaient les professionnels, les enseignants et chercheurs et les très nombreux doctorants intéressés par l’IA.

Auditorium du théâtre Meydene, en plein cœur du nouveau quartier de « M Avenue Marrakech »
En organisateur principal des RMM, qu’il a institué en 2023, le Professeur Nabil Ouarsafi, de l’université Hassan 1er ouvrait la conférence plénière suivi par :
- le Pr. Belaid Bougadir, président de l’Université Cadi Ayyad ;
- le Pr. Abdelatif Moukrim, président de l’Université Hassan 1er ;
- le Pr. Moulay Ahmed Lamrani, président de l’École HEEC ;
- le Dr. Elmaati Errachiq, p.d.-g. du Groupe Oliviers Santé ;
- le Pr. Jamal Zahi, doyen de la Faculté d’Économie et de Gestion de Settat ;
- et le Pr. Éric Le Deley, doyen de l’ISTEC Business School Paris.

Les Rendez-vous du Management de Marrakech 2024
Le rôle d’une « IA générative et nouvel accélérateur de l’innovation et de la digitalisation des organisations » a été le cœur des interventions des participants de la table ronde qui aura suivi. Cette dernière, animée par le Professeur Hicham EL Bayed, directeur du Centre d’Information, d’Orientation et de Carrière de l’Étudiant (CIOCE) de l’Université Hassan 1er, et chroniqueur sur Atlantic Radio, a rassemblé :
- M. Abdellatif El Rhadouini, comme représentant de Mme Imane Belmaati, directrice générale de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), établissement public marocain placé sous la tutelle de l’État ;
- le Pr. Ibrahima Fall, président de Hommes & Décisions et fondateur de l’Institut du travail réel ;
- la Professeure des Universités, Bérangère Lauren Szostak, de l’ISM-IAE de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (implanté au sein de l’Université de Paris-Saclay), ainsi que directrice du Laboratoire de Recherche en Management (LAREQUOI) ;
- et le Professeur Mustapha Chagdali de l’Enseignement Supérieur à l’ISIT, un psycho-sociologue membre de la Société Marocaine de Psychologie.

Cela a donné l’occasion, grâce à des débats fructueux, de mettre en lumière les opportunités comme les défis posés par cette technologie émergente dans le contexte managérial non seulement marocain mais aussi international.
L’Université Cadi Ayyad, partenaire des RMM2024, au cœur du débat sur IA et recherche/enseignement
En matinée de la dernière journée, les participants se sont retrouvés dans la magnifique salle du centre de conférences de l’Université Cadi Ayyad que préside le Professeur Blaïd Bougadir.
La thématique du matin était, bien entendu, l’intégration de l’IA mais cette fois dans l’enseignement et la recherche en management. Des intervenants venus de plusieurs horizons et pays différents apportaient des éclairages complémentaires, enrichissant le débat qui avait attiré une assistance nombreuse.
C’est le professeur Nabil Ouarsafi de l’Université Hassan 1er qui menait habilement les débats et passait la parole aux intervenants de ce carrefour d’échanges avec :
- le Professeur Adil Berrazzouk, un enseignant-chercheur à HEEC Marrakech ;
- le Professeur Philippe Naszályi, directeur de La Revue des Sciences de Gestion (LaRSG) ;
- le Professeur Abdelmounim Belalia, directeur général de l’Université Mundiapolis de Casablanca ;
- le Docteur Amine Rossafi, directeur exécutif de l’Académie de l’EFE, Maroc Academy, une entreprise sociale affiliée à EFE-Maroc (la fondation marocaine de l’éducation) ;
- le Professeur Djadou Tanoh Pascald, directeur pédagogique de Vatel ;
- ainsi que le Docteur Abdelhaq Mouhtaj, enseignant-chercheur et ancien directeur de l’Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger (ISITT).

En fin de matinée, une Master Class, sur le schéma d’une conférence pour les professionnels de santé a permis de nourrir des échanges avec la salle. M. Thomas Denayer, directeur de communication des Cliniques Universitaires Saint-Luc et de l’Université Catholique de Louvain (Bruxelles) et Mme Yosr Benhamadi Sanchez, experte en management hospitalier et en gestion des risques pour le Cabinet 2D-MED ont déployé leurs expériences pour nourrir les interventions des participants.
Ces deux interventions ont été complétées et animées par la culture du professeur honoraire Mohamed Hamidi, de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech, membre particulièrement actif au sein de la société civile et auprès des associations savantes traitant des questions de santé au Maroc.
RMM 2024 : Des ateliers de méthodologie de recherche pour les doctorants
Toujours à la suite de cette matinée de ce vendredi 13 décembre, des sessions parallèles ont été organisées jusqu’à 18 heures. Vu le nombre des participants, ce n’est pas moins de 18 ateliers pratiques rassemblant 119 doctorants qui ont dû être organisés.
Ces sessions parallèles ont exploré en profondeur divers aspects de l’IA dans le management grâce à l’implication d’un pool d’enseignants chercheurs, à l’exemple de celui sur les études de cas augmentés par l’IA tenu par Mme Dominique Baruel Bencherqui, la directrice de la recherche à l’ISTEC Business School et chercheuse au Prism Sorbonne de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.
Tous ces ateliers ont ainsi permis aux jeunes participants d’approfondir leur pratique face à 54 professeurs aguerris, leur permettant de progresser dans leurs travaux de recherche et méthodologie.
RMM 2024 : une grande occasion de « networking » autour de l’IA
Les Rendez-vous du Management de Marrakech 2024 se sont imposés comme un carrefour d’échanges incontournable pour comprendre et anticiper les mutations induites par l’IA dans le monde des organisations. Les RMM 2024 ont non seulement permis d’appréhender l’état des lieux des avancées actuelles, mais également esquissé des pistes pour l’avenir du management dans un monde de plus en plus façonné par l’intelligence artificielle.
Les RMM 2024 ont offert, dans ce sens, une plateforme de réflexion approfondie de grande valeur sur les opportunités et les défis de l’IA dans le management. Les discussions ont abordé des questions éthiques cruciales, telles que la protection de la vie privée, la transparence des algorithmes et l’équité dans la prise de décision assistée par IA.
L’impact sur les pratiques managériales a été examiné sous tous les angles, de la prise de décision stratégique à la gestion opérationnelle quotidienne… Les participants ont notamment exploré comment l’IA pourrait redéfinir les rôles de leadership, transformer les processus organisationnels et influencer la culture d’entreprise.
La transformation du travail induite a été un sujet central, avec des débats sur l’évolution des compétences requises et la nécessité d’une formation continue face à l’automatisation croissante.
Les RMM sont désormais le rendez-vous incontournable de la pensée managériale francophone !