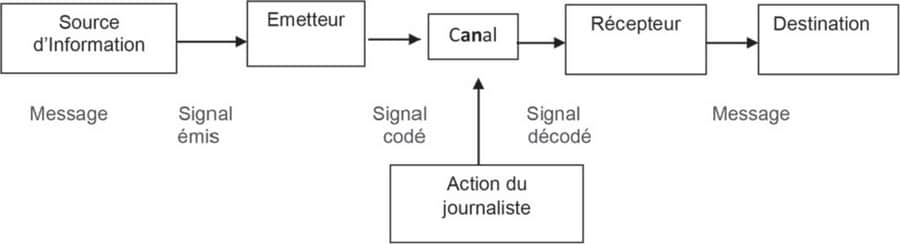Directeur de LaRSG
« Le travail, c’est la santé… rien faire, c’est la conserver », chantait Henri Salvador avec l’humour du paradoxe. C’était en 1965. Cette même année, naissait la revue Direction et Gestion des Entreprises, devenue depuis La Revue des Sciences de Gestion. Soixante ans plus tard, le refrain résonne encore, dans un monde où le travail est à la fois revendiqué, transformé, désacralisé… et souvent pathogène.
Nous avons choisi de faire de ce titre de chanson le point de départ de notre numéro 333, deuxième numéro de notre soixantenaire, à la tonalité volontairement libre, critique et inspirée. Car dans « 333 », on entend aussi ce fameux « 33 » qu’on disait chez le docteur !
333 avant notre ère, c’est aussi Alexandre le Grand qui bat Darius III à Issos, ouvrant la voie à la conquête de l’Orient. Ce numéro n’a pas cette ambition, mais se veut à sa manière un point d’inflexion – qui raisonne et résonne – une invitation à regarder autrement nos certitudes, nos normes… et nos pratiques.
Fidèle à sa tradition d’ouverture à la réflexion, et quelle réflexion : voir ce que la finance ne montre pas, La Revue des Sciences de Gestion s’ouvre par une tribune libre de Jean-Jacques Pluchart, qui présente « Les invisibles de l’emprise de la finance ». Il y évoque l’un des paradoxes les plus puissants du capitalisme contemporain : sa visibilité hégémonique et son invisibilité concrète. À la manière du mythe de la caverne de Platon, l’auteur nous entraîne à la découverte de la « banque de l’ombre », des réseaux de blanchiment, des flux spéculatifs hors radar et de ces puissances anonymes qui structurent les marchés sans visage.
De là découle un court dossier : approches pluriculturelles en finance, qui aborde la finance plurielle, entre normes et cultures des sociétés foncières européennes aux microcrédits africains. Charlotte Disle et Rémi Janin (Université Grenoble-Alpes) analysent l’usage du résultat EPRA comme indicateur alternatif de performance dans le contexte des normes IFRS, révélant à la fois ses apports et ses limites pour les sociétés foncières européennes. En écho, Pascal Bougssere, Mamadou Toé et Wend-Kuûni Raïssa Yerbanga étudient les perceptions croisées du microcrédit au Burkina Faso, à travers les rapports entre institutions de financement et performance réelle des micro-entreprises. Ces contributions montrent combien la finance reste un construit culturel, façonné par les normes, les institutions… et les perceptions qui sont importantes en santé mentale.
Sans transition, soigner autrement : démocratie, numérique et management de la santé sont autant de pistes pour la gestion de la santé dans tous les continents. Xavier Moinier et Liliane Bonnal montrent comment la e-santé peut accroître le pouvoir d’agir du patient, dans une logique de démocratie sanitaire active. Une contribution de Kaouther Ben-Jemaa-Boubaya (EDC-Paris) et Boutheina Zouabi-Ouadrani (La Réunion) analyse l’impact de l’agilité organisationnelle sur le stress professionnel des cadres de santé français, en contexte post-Covid. Du côté de Bamako, l’étude sur les médicaments traditionnels informels interroge le rôle ambivalent des réseaux sociaux numériques dans la circulation des produits de santé.
Enfin, Nabil Ouarsafi et Elmaati Errachiq explorent les obstacles organisationnels au Lean healthcare dans les établissements sanitaires du Maroc, confrontant modèle importé et culture hospitalière.
Là encore, le monde entier est concerné, et pas ce petit bout étriqué qui n’a que l’Outre-Atlantique comme horizon ultime !
Ces travaux s’inscrivent aussi dans notre partenariat durable avec la Chaire de gestion des services de santé du CNAM, dirigée par le Professeur Sandra Bertezene, partenaire indispensable de La RSG pour la troisième année dans nos colloques sur la démocratie en santé.
L’idée de la santé et de son lien avec la gestion n’est plus une vue de l’esprit. Déjà dans le numéro précédent, j’amorçais la réflexion sur le fait que le manager est aujourd’hui un acteur-clé de la santé mentale au travail[1], souvent plus influent que les soignants eux-mêmes. J’y relevais le paradoxe que le gestionnaire, si décisif dans le quotidien des entreprises, est pourtant absent des débats publics. Il ne s’agissait pas de défendre une discipline, mais de rappeler que la gestion, ou le management, mérite toute sa place dès qu’il est question d’organisation humaine.
Cela résonne d’autant plus aujourd’hui, au moment où le Gouvernement confie à Teddy Riner, triple champion olympique de judo, l’un des sportifs les plus titrés et les plus populaires de France, le parrainage de la Grande Cause nationale 2025 : la santé mentale. Un choix symbolique qui honore l’effort et la performance, mais qui doit aussi s’accompagner d’une réflexion sérieuse sur les causes structurelles du mal-être, notamment dans le travail. Le management n’est pas un simple outil de gestion du quotidien : il est aussi, souvent, un déterminant de santé.
Le constat est accablant : en France, selon les données de l’Assurance Maladie, plus de six cent mille accidents du travail sont déclarés chaque année, et près de cinquante mille maladies professionnelles reconnues. Le secteur de la construction, de la logistique, mais aussi celui de la santé et de l’aide à la personne figurent parmi les plus touchés. Le travail ne préserve pas la santé : il l’altère trop souvent.
Toutefois, il convient de ne pas oublier que le travail peut aussi être facteur d’insertion, notamment pour les personnes en situation de handicap. Ainsi, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) permettent à des milliers de travailleurs handicapés d’accéder à une activité professionnelle adaptée, source de reconnaissance, de lien social et d’équilibre personnel. Mais il y a ici une condition qui l’emporte sur toute autre considération, que l’on n’oublie pas, comme le fait pourtant la dangereuse réforme gouvernementale des ESAT, initiée par la calamiteuse Sophie Cluzel que le travail doit y aussi et surtout ici, ne pas jeter aux orties, l’aspect médico-social[2].
C’est une piètre justification pour s’exonérer de l’absence d’anticipation dans la formation des personnels de santé qui manquent cruellement. Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), notamment les ESAT, les difficultés de recrutement sont nettes : le taux de vacance atteint 2,3% aujourd’hui, et près de 4% en moyenne dans l’ensemble des structures médicosociales[3]. Malgré leur vocation inclusive, ces établissements peinent à pourvoir des postes clés. L’absentéisme, lui, a crû durant la crise sanitaire (11,5 →13% en 2020), témoignant des pressions croissantes sur les personnels. Ce défaut de dotation, que les ESAT partagent avec les services multi-clientèle, inquiète : il fragilise leur mission d’insertion professionnelle et sociale. »
C’est aussi oublier, excusez du peu, que 80 % des handicaps sont « invisibles », psychiques ou cognitifs, non détectables à l’œil nu[4]. Le mythe du travail en milieu ordinaire pour tous est un crime contre la vérité, les faits et l’intelligence.
Le sens du travail ne se résume donc pas à sa pénibilité ou à ses risques, mais se construit aussi dans la capacité à inclure et à valoriser chacun selon ses possibilités.
Et le Covid-19, loin de réduire les risques, les a déplacés. Le télétravail, devenu très souvent une forme banale d’organisation, entraîne des risques nouveaux : isolement, effacement des limites entre vie professionnelle et personnelle, troubles musculosquelettiques, et surtout fatigue psychique accrue. Travailler chez soi n’est pas toujours plus sûr. C’est aussi un mode de stress invisible.
C’est pour inclure toutes ces réflexions que se tiendra sommet francophone du management que La Revue des Sciences de Gestion à Marrakech, les 10, 11 et 12 décembre 2025, en partenariat avec les Rendez-Vous du Management, initiés par le Professeur Nabil Ouersafi à l’occasion de son soixantenaire. Ce colloque, à la fois pluridisciplinaire et ouvert à la diversité des approches et des terrains, portera sur le thème général du Travail, décliné autour de deux appels à communication[5] :
- Travailler plus ? Travailler moins ? Ou travailler autrement ?
- Pouvoir d’agir des usagers en Europe, en Amérique, en Afrique… : Partager les savoirs pour une plus grande démocratie en santé : Travailler autrement.
Alors oui, « Le travail, c’est la santé », mais à condition qu’on cesse d’en faire une incantation vide. À condition qu’on réinterroge les formes, les finalités, les rythmes, les rapports sociaux. À condition que le travail ne soit plus ce qu’il empêche, mais ce qu’il permet.
Comme le rappelait déjà l’Organisation Internationale du Travail en 2019, plus de 2,7 millions de personnes meurent chaque année d’un accident ou d’une maladie liée au travail, et quelque 374 millions d’accidents non mortels sont signalés.
En France, malgré les dispositifs de prévention, les chiffres restent préoccupants. C’est donc à une mobilisation scientifique, managériale et sociale que ce numéro appelle.
Dans cet esprit, nous renouvelons l’engagement de La Revue des Sciences de Gestion depuis 60 ans : analyser, critiquer, transmettre.
Et, si l’on devait encore ausculter le monde de la gestion… alors oui, comme chez le docteur, disons 33. C’est justement ce que proposait l’illustre René Laennec, professeur à la Faculté de médecine de Paris, en 1816. Inventeur du stéthoscope, il introduisit cette forme d’écoute directe des sons du corps, l’auscultation, en demandant à ses patients de prononcer le nombre « 33 », dont les vibrations thoraciques facilitaient l’examen des poumons. À l’époque, le stéthoscope n’était qu’un simple cylindre de bois, mais son innovation ouvrait la voie à une médecine plus rigoureuse, fondée sur l’observation et l’écoute plutôt que sur la seule spéculation intuitive. Tout ce qui est aussi notre finalité.
Sachons aussi que dans les pays anglophones, le médecin disait « ninety-nine ». Comme quoi, la santé-comme la gestion a toujours parlé plusieurs langues.
C’est cette richesse pluriculturelle, loin des modèles figés, que nous défendons depuis 60 ans à La RSG !
2. Dispositions des décrets des 13 et 22/12/2022. Mesures annoncées par le Président de la République lors de la Conférence Nationale du Handicap du 26/04/2022. Déploiement de la Loi Plein Emploi : inscription dans la loi de finance 2025
3. Entre 2017 et 2023, le taux de vacance moyen dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) a quasiment doublé, passant de 2,1 % à 4,5 %. Dans les ESAT, ce taux est plus faible qu’ailleurs, autour de 2,3 % en 2023, contre 6,9 % dans les MAS pour adultes handicapés, source cnsa.fr. Le secteur des services multiclientèle (SAAD, SSIAD…) affichait des vacants jusqu’à 7,7 %, sensibilisant aux difficultés de recrutement dans le medico‑social. Source Repères statistiques, n°24 Avril 2025 “Absentéisme, vacance et rotation dans les établissements et services médico-sociaux” par Myriam Lévy (Direction de la prospective et des études) CNSA.fr et Le Média social, 23 avril 2025, “Dans les ESMS, l’absentéisme est revenu à son niveau d’avant-Covid”
4. Source : chiffres clés du Handicap, Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, 14 avril 2025.
5. https://www.larsg.fr/sommet-francophone-du-management-double-appel-a-communication/