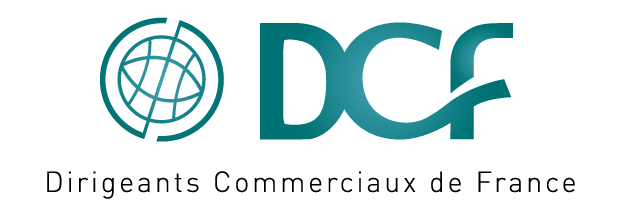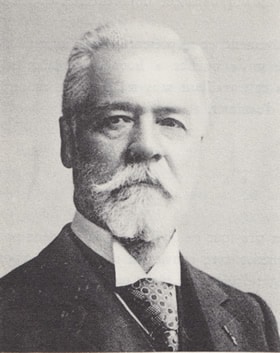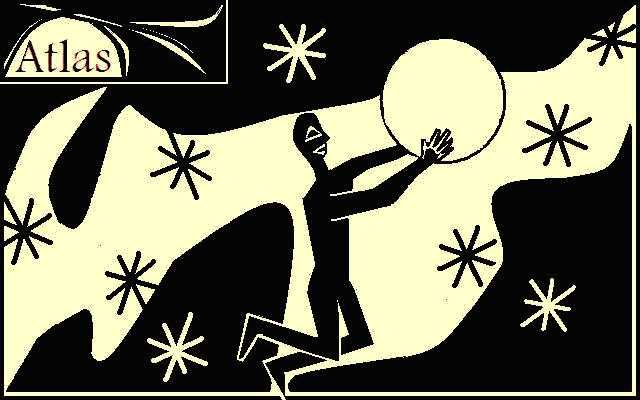Voici un appel à communication sur la planification en Afrique pour lequel nous rappelons l’ouverture des archives de Jacques Foccart.
Dossier coordonné par Boris Samuel : planification en Afrique
Chaire d’études africaines comparées, EGE-Rabat / SciencePo-CERI

Depuis 2000, la lutte contre la pauvreté et les Objectifs du millénaire pour le développement (remplacés par les Objectifs de développement durable en 2015) ont entrainé l’emploi des procédés néolibéraux de la nouvelle gestion publique (new public management), incarnés en Afrique par la « gestion axée sur les résultats » (Egil 2015 ; Fioramonti 2014 ; Samuel 2013) ; mais ils ont aussi induit des appels au retour d’un Etat planificateur, volontariste, et à l’emploi de techniques rappelant l’ingénierie du développement des années 1960, parfois importée des pays du bloc soviétique (Ward 2004 ; Ziai 2011). Ces hybridations ne doivent pas surprendre : comme l’ont montré des travaux récents, le planisme d’inspiration soviétique et la gestion néolibérale par indicateurs présentent des similitudes dans les formes et les mécanismes (Hibou 2012 ; Salais 2013 ; Supiot 2015). De tels constats incitent à questionner les significations que recouvrent les pratiques de pilotage des politiques de développement. Derrière une apparente unicité de forme, la planification peut être porteuse d’une multiplicité de répertoires politiques qui doivent être compris à la lumière des trajectoires historiques nationales (Laborier et Trom 2003).
Après des décennies 1980 et 1990 dédiées à la privatisation et à la « décharge » (Hibou 1999), les interventions directes de l’Etat sont à nouveau au goût du jour dans le développement. L’« inclusion », devenue un des nouveaux mots d’ordre des organisations internationales depuis les printemps arabes de 2011, se traduit par la mise en place de filets sociaux, de subventions à la consommation, de programmes d’emploi de jeunes chômeurs, ou de programmes de transferts monétaires aux « pauvres » (Bono 2010 ; Ferguson 2015 ; Sardan et al. 2014). A l’heure où les logiques entrepreneuriales et capitalistes prennent le haut du pavé dans les sociétés du continent (Cooper 2014 ; Kelsall 2013), les discours sur l’ « émergence » poussent en outre les Etats à reprendre un rôle de modernisateur et de développeur. Ils revitalisent les directions et agences en charge de la promotion de l’investissement et lancent des programmes d’infrastructure, d’aménagement du territoire ou de développement des communications, tout en les couplant avec des réformes réglementaires et de libéralisation censées attirer les investisseurs. Ces interventions témoignent de l’entrée dans une période de pluralisation des pratiques et discours économiques en Afrique. Le dossier étudiera les modes d’action des Etats qui impulsent, financent et pilotent ces politiques.
Planifier et gouverner en Afrique, de la période coloniale au XXIe siècle
Utiliser le terme de planification pour évoquer l’Afrique contemporaine peut sembler anachronique : l’Etat africain développementaliste et volontariste a connu jusqu’aux années 1970 de très importants échecs, et depuis les années 1980, l’ajustement structurel a fortement affaibli les institutions étatiques (Cooper 2014) si bien que l’Etat planificateur est censé avoir laissé sa place au laisser-faire et aux technologies néolibérales de la privatisation. Pourtant, la planification demeure un site majeur d’énonciation du politique dans les pays dits « en développement ».
Itinéraires planificateurs
La figure de l’Etat planificateur, au cœur de répertoires et d’imaginaires politiques, reste un horizon de pensée : mémoires de l’Etat bienfaiteur, frustration de sa disparition sous le coup de l’ajustement, ou appel au retour du volontarisme développementaliste orientent les demandes d’Etat (Lachenal et Mbodj-Pouye 2014), les débats publics (Bonnecase 2013 ; Siméant 2014) et les discours officiels (Hibou 2011). En outre, au sein des appareils administratifs nationaux les directions du « plan » ont longtemps été de hauts lieux de l’économie politique du développement, jouant un rôle central non seulement dans la formulation des politiques économiques et sociales, mais aussi dans les circuits d’accumulation liés à la gestion de l’argent de l’aide et des « projets », à la rencontre de la « politique du ventre » (Bayart) et des savoir-faire du Gatekeeper State (Cooper). Aujourd’hui, les administrations en charge de la programmation des politiques et des investissements sont encore souvent désignées par le terme de « plan », et leurs fonctionnaires par celui de « planificateurs », même lorsqu’un pays ne possède plus officiellement de direction du plan. Par le biais des réalités institutionnelles ou des imaginaires politiques, le « Plan » continue de recouper une réalité sociale multiforme.
Des techniques aux situations politiques
Aborder l’ « Afrique planificatrice » ne signifie pas limiter les observations aux processus de confection des plans. La compréhension des pratiques et discours planificateurs et de leurs effets appelle une étude des situations sociales et politiques dans lesquelles ils s’insèrent, ainsi que des domaines ou « secteurs » qu’ils entendent gouverner (filières économiques, grandes politiques publiques, villes et territoires, etc.). Les modalités de l’enchâssement de la planification dans les dynamiques sociales doivent en effet être pensées ainsi que, à l’inverse, la manière dont les plans façonnent les rapports sociaux et provoquent des transformations sociopolitiques. Etudier l’Afrique des plans demande donc de recourir à des jeux d’échelles, de prendre en compte les rapports de force qui entourent les plans, de décrire le « hors-champ » qui les accompagne (de Certeau 1990 ; Hibou et Samuel 2011). Cette démarche doit permettre de décrire la variété des situations dans lesquelles la planification est au centre de la vie sociale et politique, et de jeter la lumière sur la politisation de la technique, à l’encontre des arguments sur la dépolitisation (Ferguson 1994 ; Jobert 2003 ; Linhardt et Muniesa 2011).
Partir des techniques en action
Dans ce but, le présent dossier appelle à effectuer un déplacement méthodologique par rapport à ce qui est usuellement envisagé sur le continent : il invite à partir des techniques et outils pour étudier le politique. Les travaux qui étudient les techniques de la gestion économique en Afrique commencent maintenant à se développer, sur le calcul du PIB (Jerven 2013, Samuel 2013, Speich 2008), la mesure de la pauvreté (Bonnecase 2011, Davie 2015, Guyer 2004), l’histoire des technologies du développement (Cooper 2010 ; Desrosières 2014 ; Hodge et al. 2014 ; Morgan 2008), les recensements (Gervais et Mandé 2007). Néanmoins, les outils des administrations économiques africaines restent peu décrits[1]. La spécificité du dossier sera de proposer une description détaillée et une genèse des procédés et catégories qui guident le pilotage de l’économie. A l’instar des analyses élaborées sur d’autres zones que l’Afrique (Blum et Mespoulet 2003 ; Desrosières 2008 ; Fourquet 1980 ; Porter 1995; Tooze 2001), l’objectif sera d’analyser les techniques de la planification comme des pratiques sociales, et de rendre compte de la sociologie des acteurs de la planification, ainsi que de leurs manières de faire et de voir. Pour cela, l’approche du dossier sera bien sûr en dialogue étroit avec les travaux sur les instruments de l’action publique, qui connaissent un renouveau actuellement dans les études africaines (Eboko 2016 ; Enguéléguélé 2008), tout comme avec l’anthropologie du développement (Biershenk et Olivier de Sardan 2014), même si le dossier ne cherchera pas à opposer normes technocratiques « théoriques » et normes « pratiques » mais plutôt, en les approchant par le bas, à montrer que le maniement quotidien des outils techniques et une infinité de modes d’actions et répertoires peuvent se combiner (Hibou et Samuel 2011 ; Mosse et Lewis 2005). Diverses méthodes pourront être employées pour ce faire : sociologie politique ou économique, histoire, anthropologie, économie politique…
Axes du numéro
Plusieurs axes de recherche seront privilégiés :
L’histoire et la circulation des modèles et techniques de la planification :
L’histoire et l’historicité de la planification africaine méritent d’être revisitées. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les moments de volontarisme étatique ont jalonné les trajectoires de nombreux pays et ont donné lieu à des projets de planification ambitieux, du développementalisme post-indépendance, aux périodes socialistes de divers Etats, sans oublier les planifications impulsées dans des cadres impériaux depuis les années 1940 et 1950. Ces projets ont parfois marqué les systèmes administratifs, les histoires économiques et politiques et les imaginaires nationaux de manière durable. La circulation des modèles planificateurs de l’Empire vers les pays anciennement colonisés constitue un sujet mal connu. Plus encore, les échanges de techniques entre les pays du bloc soviétique et les pays africains, socialistes ou non, restent peu explorés. Ces circulations renvoient en outre à un ensemble plus vaste : les trajectoires de l’ingénierie planificatrice ont été portées par le biais des organisations sous-régionales, panafricaines, ou internationales – parfois au nom de coopérations essentiellement techniques (au sein de l’OPEP, ou de l’OCI…) – par des experts (Morgan 2008), par des voies universitaires (Nubukpo 2011), ou encore par des corps et réseaux professionnels (Charoy et Diop 2006) qu’il conviendra d’étudier.
Les outils et acteurs de la planification :
La résurgence planificatrice des années 2000 s’est traduite par l’apparition de nouveaux outils de planification (programmes de lutte contre la pauvreté, « plans d’atteinte » des OMD, « stratégies d’accélération » de la croissance ou de la scolarisation, etc.). Dans le même temps, l’avènement de l’ère néolibérale a induit la montée en puissance de nouveaux corps professionnels et savoirs légitimes – ceux des financiers, évaluateurs ou auditeurs (Bezès 2009 ; Eboko 2016 ; Samuel 2013 ; Strathern 2000). La multiplication des agences nationales, banques d’investissement, grands projets sectoriels a en outre conduit à la dissémination des enjeux de la planification en une myriade de sites plus ou moins émancipés de la tutelle des Etats. Les travaux de planification sont enfin conduits au sein de nouveaux réseaux d’acteurs internationaux, qu’ils soient en charge de faire respecter de nouvelles normes de la « bonne gestion » ou de la conduite d’opérations de développement. Les propositions pourront porter sur ces nouveaux acteurs et pratiques à partir de l’examen détaillé de systèmes de planification nationaux ou sectoriels (éducation, santé, environnement…) à différentes périodes historiques. Elles pourront aussi envisager de décrire la « chaine planificatrice »[2], afin de faire apparaître les interactions entre la myriade d’acteurs et d’institutions qui participent à la production des plans. Par extension, les modes de diffusion, les critiques, débats et controverses suscités par les plans pourront aussi être étudiés. Les modes de « vulgarisation » des récits issus de la planification (discours des Etats, des médias, des partis et associations etc.) doivent en effet être saisis pour analyser leur rôle dans l’exercice du pouvoir. Pour cela, les approches de sociologie des sciences et techniques (Lampland 1996) pourront se combiner à celles de la sociologie, de l’anthropologie, ou la science politique.
Les répertoires politiques et imaginaires de la planification :
Les plans et leurs modèles formalisent des représentations et imaginaires du monde social (Desrosières 2008 ; Morgan 2012). Ils mettent en chiffres les visions téléologiques du progrès social et du développement ainsi que les représentations de l’Etat frugal, de l’Etat généreux et volontariste, ou encore porteur de maitrise l’espace et du territoire, etc. Les articles pourront proposer d’identifier la manière dont ces imaginaires se sont construits, ont cheminé, ou dont ils sont mobilisés dans une diversité de situations sociales. Ils pourront aussi mettre en lumière le fait que les catégories de description de la réalité utilisées par les plans peuvent être saisies par leur généalogie technicienne comme par leur ancrage dans des mondes sociaux pluriels (Bowker et Star 1999), au sein desquels elles se sont forgées et imposées. La planification est en outre un mode d’énonciation du politique (Hibou et Samuel 2011). De nombreux clivages, revendications ou discours politiques plus ou moins contestataires trouvent à s’exprimer au sein des travaux de planification, ou se construisent sur les scènes politiques et sociales autour des figures de l’Etat planificateur. Les récits issus des plans peuvent aussi, à l’inverse, servir d’instrument de normalisation (Bono 2010 ; Hibou et Samuel 2011), en peuplant par exemple les discours d’allégeance aux régimes.
Les marges de la planification :
Enfin, les formes de l’action planificatrice peuvent être très diverses. La planification n’est pas toujours le fait de l’action d’Etats omniscients, volontaristes et visionnaires. Les procédures et travaux de planification de nombreux pays sont, ou ont été réalisés par les agences internationales, qui se substituent aux administrations nationales (Soudan du Sud, Centrafrique, Guinée Equatoriale etc.). A l’inverse, en l’absence de soutien international, des quasi-Etats (comme le Somaliland) parviennent à stabiliser des procédures administratives et institutionnelles qui sont en rupture avec le formalisme économique international, mais permettent la gestion étatique. Les techniques planificatrices peuvent aussi être portées par des acteurs privés dans une logique de décharge, par exemple dans des services publics privatisés au profit d’entreprises, de grandes ONG ou d’Eglises. Par ailleurs, la planification ne s’adresse pas uniquement aux politiques de développement dans leur acception restreinte, sociale ou économique. Dans de multiples situations, la violence ou la guerre sont étroitement reliées, voire organisées par une logique de planification (Rwanda). Nom-breuses sont aussi les situations d’urgence, par exemple alimentaires, dans lesquelles la planification guide les interventions des acteurs. Le lien entre les techniques planificatrices et la gestion d’Etats d’exception ou d’urgence mérite d’être considéré, notamment en mettant au jour les manières dont un exercice autoritaire ou violent du pouvoir peut se combiner avec la promotion d’une rationalité bureaucratique (Blum et Mespoulet 2003 ; Tooze 2001 ; Samuel 2014).
Calendrier
10 juin 2016: envoi des propositions d’article (1 page maximum) à Boris Samuel (boris.samuel@sciencespo.fr)
24 juin 2016: notification aux auteurs des propositions retenues
25 octobre 2016: envoi des articles retenus au comité de rédaction de la revue (50’000 signes, espaces et notes de bas de page compris)
Oct. 2016-Févr. 2017 Evaluation, révision et traduction éventuelle des textes retenus par la rédaction de la revue
Le dossier sera publié dans le numéro de mars 2017. Les propositions d’articles peuvent être envoyées en français ou en anglais. La publication finale sera en français.
Bibliographie
Anders, In the Shadow of Good Governance: An Ethnography of Civil Service Reform in Africa, Leiden, Brill, 2010.
J.F. Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 2006 (1989)
Bierschenk et J.-P. Olivier de Sardan (dir.), States at Work. Dynamics of African Bureaucracies, Leyde, Brill, 2014, p. 249-269
Bezès, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), PUF, Paris, 2009
Blum et M. Mespoulet, L’Anarchie bureaucratique. Statistiques et pouvoirs sous Staline, La Découverte, Paris, 2003
Bonnecase, La pauvreté au Sahel. Du savoir colonial à la mesure internationale, Paris, Karthala, 2011,
Bonnecase « Politique des prix, vie chère et contestation sociale à Niamey: quels répertoires locaux de la colère ? », Politique Africaine n°130, 2013
Bono, « L’activisme associatif comme marché du travail. Normalisation sociale et politique par les « Activités génératrices de revenus » à El Hajeb »,
Politique africaine, 2010/4 N° 120, p. 25-44
Bowker et S.L. Star, Sorting Things Out. Classification and its Consequences, The MIT Press, Cambridge, 1999
de Certeau, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Gallimard, Folio Essai, Paris, 1990 (1980)
Charoy, L. Diop, « Le CESD – Paris : au service de la formation statistique », Stateco, 100, Paris, 2006 pp. 63-68
Cooper (dir.), « Writing the history of Development », Journal of Modern European History, vol. 8-1, 2010.
Cooper, Africa in the World, Capitalism, Empire, Nation-State, Harvard University Press, 2014
Davie, Poverty Knowledge in South Africa. A Social History of Human Science, 1855–2005, Cambridge University Press, 2015 ;
Desrosières, Prouver et gouverner, Paris, La Découverte, 2014
Desrosières, Pour une sociologie historique de la quantification : L’Argument statistique I. et Gouverner par les nombres. L’Argument statistique II. Paris, Presses des Mines, 2008.
Egil, « Les Objectifs de développement durable, nouveau Palais de cristal ? », Politique Africaine, 140, décembre 2015
Eboko, Repenser l’action publique en Afrique. Du sida à l’analyse de la globalisation des politiques publiques, Karthala, 2015
Enguéléguélé, « Quelques apports de l’analyse de l’action publique à l’étude du politique en Afrique subsaharienne », Politique et Sociétés, vol. 27, n°1, 2008, p. 3-28
Ferguson, The Anti-Politics Machine.’Development’, Depolitization and Bureaucratic Power in Lesotho, Minneapolis, University of Minneapolis Press, 1994.
Ferguson, Give a man a fish. Reflections on the New Politics of Distribution, Duke University Press, Durham and London, 2015
Fioramonti How Numbers Rule the World : the Use and Abuse of Statistics in Global Politics, Zed Books, 2014
Fourquet, Les comptes de la puissance. Histoire de la comptabilité nationale et du plan, Encres, éditions recherches, Paris, 1980
Gervais, I. Mandé, « Comment compter les sujets de l’Empire ? Les étapes d’une démographie impériale en AOF avant 1946 », Vingtième siècle, n°95-3, 2007, pp. 63-74
Guyer, Marginal Gains: Monetary Transactions in Atlantic Africa,Chicago, University Of Chicago Press, 2004.
Hibou, « La « décharge », nouvel interventionnisme. », Politique africaine n° 73, 1999, pp. 6-15
Hibou, La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, La Découverte, 2012
Hibou et B. Samuel, « Macroéconomie et politique en Afrique: Introduction au Dossier ‘La macroéconomie par le bas’ », Politique africaine, 124, décembre 2011, pp. 5-28
Hodge, G. Hödl, M. Kopf (dir.), Developing Africa: Concepts and Practices in Twentieth Century Colonialism, Manchester University Press, 2014
Jerven, Poor Numbers: How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do About It. Cornell University Press. Ithaca and London, 2013
Jobert, « Le mythe de la gouvernance dépolitisée », in Pierre Favre et al., Être gouverné. Études en l’honneur de Jean Leca
, Presses de Sciences Po, 2003 p. 273-285.
Kelsall, Business, Politics and the State in Africa. Challenging Orthodoxies on Growth and Transformation. Zed Books, 2013
Laborier et D. Trom (dir.), Historicités de l’action publique, PUF, Paris, 2003
Lachenal et A. Mbodj-Pouye, « Restes du développement et traces de la modernité en Afrique. Introduction au dossier Politiques de la nostalgie », Politique Africaine, n°135, septembre 2014
Lampland, The Object of Labor. Commodification in Socialist Hungary, University of Chicago Press, 1996.
Linhardt, F. Muniesa, « Tenir lieu de politique. Le paradoxe des « politiques d’économisation »», Politix 3/2011 (n° 95) , p. 7-21
Mosse et D. Lewis (dir.), The Aid Effect: Giving and Governing in International Development, Pluto Press, Londres, 2005
Morgan, « On a Mission with Mutable Mobiles », Working Papers on the Nature of Evidence: How Well Do ‘Facts’ Travel?, No. 34/08, Department of Economic History, London School of Economics and Political Science, 2008
Mary S. Morgan, The World in the Model. How Economists Work and Think, Cambridge University Press 2012.
Nubukpo « Les macroéconomistes africains : entre opportunisme théorique et improvisation empirique », Politique Africaine, 124, décembre 2011, pp. 87-99
J.P. Olivier de Sardan, O. Hamani, N. Issaley, Y. Issa, H. Adamou, I Oumarou, « Les transferts monétaires au Niger : le grand malentendu. », Revue Tiers Monde 2/2014 (n° 218) , p. 107-130
Porter, Trust in numbers: the Pursuit of Objectivity in Science and Public Life.Princeton University Press, 1995
Salais, Le viol d’Europe, Enquête sur la disparition d’une idée, PUF, 2013
Samuel, La production macroéconomique du réel. Formalités et pouvoir au Burkina Faso, en Mauritanie et en Guadeloupe, thèse de doctorat, IEP de Paris, 2013
Samuel, «Statistics and Political Violence: Reflections on the Social Conflict in 2009 in Guadeloupe », Partecipazione e Conflitto, Vol. 7, no. 2, juin 2014
Siméant, Contester au mali. Formes de la mobilisation et de la critique à Bamako, Karthala, 2014
Speich, « Travelling with the GDP through early development economics’ history », Working Papers on the Nature of Evidence: How Well Do ‘Facts’ Travel?, No. 33/08, Department of Economic History, London School of Economics and Political Science, 2008
Strathern, (dir.) Audit Cultures: Anthropological Studies in Accountability, Ethics and the Academy, Routledge, Londres, 2000
Supiot, La gouvernance par les nombres-Cours au Collège de France 2012-2014, Fayard, 2015
Tooze, Statistics and the German state 1900-1945: The making of modern economic knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, 2001
Van de Walle, African Economies and the Politics of Permanent Crisis, 1979–1999, Cambridge University Press, Cambridge, 2001
Ward, Quantifying the World. UN Ideas and Statistics, Bloomington, Indiana University Press, 2004
Ziai, « The Millennium Development Goals: back to the future? »,Third World Quarterly, 32:1, 2011
[1] Quelques exceptions notables étant par exemple Van de Walle (2001) ou Anders (2010)
[2] En paraphrasant Alain Desrosières qui invitait à étudier la « chaine de production statistique »