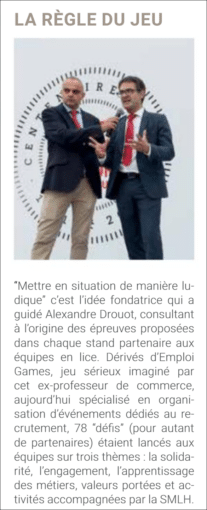Voici la vidéo intégrale de la réunion animée par Thomas Parisot. Directeur général adjoint de la plateforme Cairn.info, Thomas Parisot est par ailleurs président du Groupement français des industries de l’information (gf2i) et participe activement aux travaux du groupe universitaire du Syndicat national de l’édition (SNE), dont il est vice-président.
00:00:00 Thomas Parisot
Nous voilà maintenant donc enregistrés. Donc à partir du moment, tout ce qu’on dit peut-être retenu contre nous. Mais l’idée là, c’est d’être très factuelle et non pas polémique pour après, on pourra avoir des débats et des échanges tout à fait ouverts. Mais là c’était un premier moment, comme je disais, très factuel pour pouvoir resituer cette question des classements. Et avant ça peut être simplement cette notion de métrique d’impact qui est un peu au cœur de notre sujet, de nos questionnements de ce matin.
Métriques d’impact, qu’est-ce que ça veut dire ? C’est des termes qu’on voit un peu partout.
Bon, aujourd’hui, y a beaucoup de choses qui sont sur la table.
Difficile de se promener dans des plateformes académiques scientifiques sans voir ensemble de chiffres, un certain nombre de nombres, voire de calculs qui effectivement émanent de la production scientifique et d’une certaine façon de l’aval de ça qui est sa consultation, sa circulation.
Donc, on compte sur les plateformes aujourd’hui et on restitue de plus en plus largement le nombre de publications, des auteurs, des revues. Bon, le nombre de citations enregistrées, très classique, très connu, très publicisé, puisque vous savez que ce mouvement de calcul des citations remonte vraiment aux années 70 hein. On va pas faire un cours d’histoire mais c’est connu effectivement, mais avec des calculs qui, voilà, permettre de connaître un peu le ratio et l’impact des travaux scientifiques à partir de la circulation des citations et de leur traçabilité qui est aujourd’hui très bonne dans le monde scientifique, hein ? Par différents ensemble. Y a aussi une notion qui monte un peu, qu’on voit émerger plutôt soit des réseaux sociaux et des sites de presse qui sont des formes de sauvegarde, de partage. Sur CAIRN, on dirait de mise en liste de lecture finalement donc, qui sont des
Appropriations, des signes on va dire d’appropriation par le lectorat de certains articles – plus ou moins fort et aussi la notion plus directe encore d’usage de lecture, qu’on voit apparaître maintenant plus en plus directement sur des articles, des revues, des auteurs hein, avec des données d’audience qui sont de plus en plus publics et partageables.
Tout ça, on pourrait d’une certaine façon considère que c’est une sorte de matière première qui ne dit rien en tant que tel, à part les éléments, voilà concrets et tout à fait pratiques qui font que y a eu 13.000 articles, 13.000 vues sur cet article, il y a eu 673 citations de cet auteur sur une période donnée ainsi de suite, donc des éléments qui apparaissent un peu factuels.
Il y en a sur CAIRN Info qui sont apparues progressivement.
Vous avez peut-être vu, qui concernent effectivement des consultations, ce qu’on appelle des ajouts, qui sont – comme on disait – des gens qui mettent ensemble d’articles dans des listes de lecture, qui les mettent en favori si vous préférez, pour les lire plus tard ou pour organiser un peu leur travail de lecture.
Y a des formes de suivi, on suit des auteurs, des revues, on suit des thématiques aussi sur CAIRN, pardon, et effectivement donc ce qui donne des éléments, tout ça étant on marketing et ça je là je pense qu’il doit avoir des spécialistes bien plus avancés que moi mais vraiment toute cette logique d’engagement que les plateformes essayent de détecter par différentes modalités qui sont des signes, on va dire d’une intensité partiellement forte – alors positive ou négative – mais autour de certains articles et effectivement avec des éléments qui permettent de situer, de commencer à traiter un peu qualitativement mais on va voir après que ces métriques, aujourd’hui, ben y a des outils où on les lit, et puis y a des outils, où on les analyse d’une certaine façon, où là effectivement on plaque du coup bien sûr des certaines logiques par rapport à ces données, à cette matière première finalement.
Alors à quoi ça sert finalement, ces métriques ?
Parce qu’aujourd’hui, notre sujet c’est bien sûr des logiques de classement de revues. C’est dans un continuum, mais souvent la discussion a tendance bien sûr à voir et à extrapoler ce sujet qui n’est pas un sujet isolé puisqu’avoir des métriques, c’est déjà un sujet intéressant d’un point de vue éditorial pour améliorer le pilotage d’une revue, d’une collection, d’un éditeur ou de ses propres travaux peut-être en tant qu’auteur, c’est un peu l’esprit de l’outil que vous voyez ici qui, vous le connaissez certainement pour celles et ceux qui sont dans les comités de rédaction des revues qu’on diffuse ou les éditeurs qui permet de regarder l’usage, comment il se structure, comment ils se caractérisent et comment il évolue dans le temps. Bon, ce sont des outils qui peuvent aider au pilotage. Cela permet, et c’est notre sujet de ce matin, de faire des classements de revue si on y tient absolument en disant voilà, j’ai besoin de classer les rêves et les travaux qui sont publiés et donc je m’appuie sur ce type de métrique. Bien sûr, ça permet – pour aller un peu plus loin – aussi derrière ça de classer des institutions.
Personne ne peut ignorer aujourd’hui la logique de classement des établissements, des laboratoires nationalement et internationalement, avec différentes logiques là aussi qui sont proposées.
Je me permets ici de signaler l’article que vous avez peut-être vu, mais qui était une petite tentative cet été avec le monde et qui en à partir des données CAIRN Info de se dire que finalement ces représentations ne sont que des représentations et que on peut agencer les choses différemment en fonction de ce qu’on veut compter. En l’occurrence, le petit classement qu’on publie avec Le Monde était celui des institutions qui déclenchaient le plus d’impact, le plus de trafic, le plus d’audience sur CAIRN et avec des débuts de caractérisation de cette audience, une piste parmi d’autres, mais qui est d’une logique et qui aboutit bien sûr à des résultats complètement différents d’autres classements basés sur d’autres outils d’analyse qui ont d’autres logiques.
Et évidemment, c’est jamais très loin, c’est particulièrement sensible dans le domaine de la santé,
Benjamin de JEL éditions connaît bien ça aussi, avec des mécanismes qui sont parfois en France ou à l’étranger, extrêmement mécaniques, avec effectivement des points et probablement au sein de la Fnege – je suis pas assez sachant pour en parler – des conséquences financières tout à fait réelles et tout à fait directes pour des établissements, pour des chercheurs qui ont… accumulent des points en fonction du rang de la revue, du rang de l’auteur et des points qui correspondent à des sommes mécaniquement versées. Le système qu’on voit ici et qui est en place aujourd’hui, le système des points SIGAPS qui détermine une partie des financements des hôpitaux français en fonction des publications de leurs chercheurs et qui effectivement, là, pose la question non plus simplement en termes académiques, philosophiques, mais en termes aussi tout à fait concret de ventilation des budgets, et de répartition des budgets.
C’est très ouvert comme ça et ça, c’est presque caricatural le système SIGAPS souvent, c’est un petit peu plus latent, ça se dit moins, mais ça se pratique dans des commissions où on évalue l’attribution des budgets à telle institution, telle autre, à telle chercheur, à tel projet de recherche bien sûr, mais tout connaissez tout ça. Des petits rappels.
Là aussi, là où on prend une dimension un peu plus technique et ou des fois, y a parfois des incompréhensions ou des éléments qui mériteraient d’être précisés, à tout le moins, c’est que toute cette matière première, elle est ingérée par des outils d’analyse.
Et aujourd’hui, il y en a assez peu.
Ce qui fait que la concentration des échanges, des débats, généralement se focalisent sur quelques-uns mais il y en finalement a finalement de plus en plus.
On dit souvent assez peu en disant : « Écoutez, y a que 2 outils dans le monde qui sont le Web of Science et Scopus ».
On voit aujourd’hui que c’est un secteur qui se réouvre un peu et d’autres logiques pour plein de raisons, effectivement, sont souhaités avec des nouveaux outils qui peuvent apparaître, on reparlera moins de Dimensions, qui est une tentative de Springer Nature, pour d’une certaine façon mimer ce qu’à fait Elsevier Scopus, effectivement, sur son corpus et des corpus proches, mais pour l’autre acteur, le challenger, on pourrait d’Elsevier à l’échelle internationale en termes de grands groupes d’édition mondialisée pour disposer lui aussi d’une infrastructure d’évaluation là-dessus, mais, et avec le Web of Science bien connu, mais il y a aussi cet nouvel entrant d’une taille critique non négligeable et intéressante, OpenAlex, qui aujourd’hui, en tout cas on peut le noter à vraiment en poupe, qui est un outil ouvert, qui part du principe que maintenant les citations, les données de citation, ne sont plus la propriété de tel et tel acteur. Ce sont des données très ouvertes sur lequel effectivement on peut composer et on peut construire son propre schéma d’analyse. Et OpenAlex, dans cet esprit d’ouverture, de science ouverte, effectivement, permet de reconstruire et, à partir de cette matière, de travailler cette matière première avec des logiques qui peuvent être un peu différentes.
Alors vous le savez effectivement, parce que toutes ces questions aboutissent, y en a beaucoup de discussions avec différents dans… voilà… revues, soit pour maintenir les classements qui sont déjà en place, soit pour les obtenir, soit bon… Pour eux, là aussi, très factuellement, repréciser un peu les choses. Vous savez que ces processus de candidature qui s’agisse d’Elsevier, qu’il s’agisse du Web of Science, ici c’est plutôt le schéma issu de la pédagogie d’Elsevier-Scopus mais sont des classements qui fonctionnent à 2 niveaux.
Il y a un acte de candidature qui doit être celui des revues. Donc, là ce corpus nous indique sur son site qu’il reçoit à peu près 3500 candidatures par an. Hein, donc là-dessus…
Que le premier stade est un stade d’évaluation formelle et complètement… une sorte de checklist administrative qui n’est pas fait par des scientifiques, mais qui fait que vous devez remplir un ensemble de critères minimum qui sont des critères assez connus pour ceux qui sont passés par ces processus, qui sont l’existence d’une charte éthique – en anglais – l’existence de résumé – en anglais – et effectivement l’existence d’une politique d’évaluation des articles claire et conforme à l’éthos minimal d’une revue scientifique académique et ainsi de suite. Il y a toute une série de checklist qu’on passe et que des opérateurs, finalement non scientifiques, vont – d’une certaine façon – constater ou ne pas constater. Et ce qui fait qu’on passe où on ne passe pas ce critère d’éligibilité, on pourrait dire. Là, la moitié des revues sont déjà écartées à ce stade-là.
Effectivement, c’est assez brutal puisqu’on a même pas pu à ce stade bien sûr, discuter du projet scientifique de la revue, de son originalité et c’est vraiment… faut le voir comme une validation administrative. On n’est pas dans la discussion, on n’est pas dans l’argumentation et on est sur une perception qui peut être plus ou moins bonne des opérateurs qu’on a en face.
On a eu un nombre de cas où manifestement les opérateurs avaient pas bien regardé, où on s’est pas bien compris, bon ! C’est peut-être un peu brutal.
2e étape, effectivement, qui est donc liée à, par exemple chez Elsevier, qui s’appelle le CSAB, qui est effectivement un organisme, un comité d’une certaine façon, qui est connu, qui est finalement… nous – on est toujours assez surpris – qui repose sur assez peu de personnes.
Vous avez la liste de cette quinzaine de personnes aujourd’hui qui fait partie de ce comité. Comme une sorte de comité de rédaction qui – à l’échelle mondiale – évalue la validité des projets de revue.
Non pas, bien sûr des articles en l’occurrence, mais des projets.
Bon, je pense qu’il faudra, c’est une liste publique, les liens que je remettais ici, on pourra vous faire passer effectivement avec Pauline, Delphine le support de présentation qu’on utilise ce matin et donc les liens pour regarder ça plus en détail si ça vous intéresse. Bien sûr, une sous-représentation assez manifeste des sciences humaines, de la gestion, des profils non nord-américains et puis – d’une manière générale – effectivement, un nombre assez réduit de personnes qui par exemple bien sûr, valide ou pas les – quand même – centaines de projets de revues qui leur arrivent chaque année donc, avec un travail qui doit être assez intense pour eux, certes, mais qui leur donne une responsabilité assez forte, donc une certaine concentration là-dessus de la vision de ce que doit être une bonne revue scientifique.
Bon, voilà, ça c’est déjà… mais là, comment dit, on est factuel.
L’autre point très factuel, c’est – et ça nous ramène ce matin à des débats plus non pas culturel, mais effectivement sur des aspects linguistiques – il faut savoir et c’est des outils qui assument ça. C’est connu depuis très longtemps et ça évolue de fait assez peu. Effectivement, que ce sont des outils très orientés linguistiquement et ça bon… Il faut… là j’ai pris un petit extrait, mais je veux dire la littérature en est pleine. Vous avez peut-être des informations encore plus fraîches que celle-ci.
Là on est sur le Web of Science, 95% du Web of Science c’est en anglais.
Or, effectivement, une partie du travail des scientifiques qui vont évaluer le potentiel de telle ou telle revue, c’est déjà de vérifier dans leur corpus existant le niveau de visibilité qu’on les revues qui candidatent, en disant : « Bah, pour ajouter une revue à un corpus, est-ce que c’est pertinent, est-ce que ça ne l’est pas ? Déjà, je vérifie par rapport à mon corpus cette revue a un certain écho.
Alors, les citations – on le sait depuis un certain nombre de temps effectivement – sont ouvertes et internationales, on peut être dans une revue francophone citer de l’anglais.
On peut être dans une revue théoriquement anglophone et siter du français, ça apparaît de fait très peu, et on sait que les index de citations sont de fait assez nationaux.
Que ce soit pour les grandes américaines – y a un fort tropisme national par plein d’effets – et là, je me lancerai pas dans des grandes explications. La littérature est assez abondante sur le sujet, par exemple, ne serait-ce que les travaux de Yves Gingras au Canada, qui est quand même bien balisé ce genre de choses dessus les tropismes, un peu de la bibliométrie, par exemple, lisible dans règles de la recherche en sciences sociales sur Cairn, mais ailleurs aussi. Voilà. Et on sait que ce tropisme logistique, ce tropisme même national, est très fort dans les outils comme le Web of Science où Scopus qui prennent d’une certaine façon l’Amérique du Nord comme point de départ.
Alors pourquoi pas ? Hein ?
Je veux dire, chaque logique est possible. Je ne sais pas, mais il y a ce tropisme très fort, ce qui fait que techniquement, très factuellement, pour une revue de langue française, intégrer ce corpus est structurellement beaucoup plus dur.
Et même quand on intègre ce corpus, les calculs de h-index, de SNIP, d’impact factor, d’abord, mécaniquement sont extrêmement faibles. C’est vraiment rentrer au fond de la salle dans un colloque très derrière, ne pas bien entendre et être tenu très à l’écoute d’un corpus qui est de fait très auto-entretenant, hein, puisque effectivement les grandes revues perçues dans ces index comme centrales distribuent d’une certaine façon un peu leur réputation, leur impact, leur aura, leur poids – symbolique – à d’autres revues quelles citent, qui décident en retour, donc y a un effet très provenant d’un noyau dur. Et même quand on intègre un petit peu la banlieue, il très très peu de chances que d’un coup, des revues francophones comme celles de la Fnege, d’un coup, deviennent au cœur de certains schémas ou réseaux de citations qui sont analysés par ces outils. Donc, c’est d’une certaine façon en effet qui est connu, y compris connu des outils eux-mêmes.
Là où c’est intéressant, et notre débat aussi ce matin – il est à la fois ancien – mais on est dans un moment où justement les choses commencent à bouger un petit peu, ce qui donne un côté à tout petit peu contracyclique, un peu anachronique, a une position un petit peu dure, comme la Fnege, puisque bien sûr on va revenir, et puis vous êtes plus informé que moi. J’imagine aussi des modalités précises de cette politique mais qu’effectivement le fait de rendre Scopus obligatoire pour une classification rang 3 et le Scopus plus le Web of Science pour le rang 2, c’est une politique qui est assez inverse à ce qu’on voit effectivement.
Maintenant dans des établissements ou chez ces outils qui lancent des index plus nationaux en disant : « Bon, c’est un fait, ce sont des index anglophones et nord-américains et donc ces outils ont 2 optiques, soit ils essaient d’imposer cette logique nord-américaine partout dans le monde. Mais de fait, en Asie, dans le monde arabe, dans le monde d’Amérique latine, y a plutôt l’idée que : « Bon, effectivement, il y a des limites à cette logique extrêmement centralisatrice et qu’il faut lancer des Index un peu plus régionaux pour avoir, ne serait-ce, voilà une vue un peu plus précise et un petit peu plus documentée de ce qui se passe dans ces bassins linguistiques. Puisque, là, on parle à la limite de régions du monde, on parle essentiellement de langues. Le web se structure aujourd’hui plus en espace linguistique, quand géographie, quand on parle en tout cas de ce type de production très internationalisée. Donc, il y a ce type d’initiative là, donc c’est le Scielo Citation Index, c’est le WoS qui l’a lancé.
Pareil pour l’Arabic Citation Index où l’ASEAN Citation Index chez Scopus qui est une logique de spécialisation de certains index et d’adaptation de ces outils à certains contextes nationaux. On les a croisés au Maroc où effectivement ils construisent avec les pouvoirs publics marocains, par exemple, des outils d’analyse propres aux besoins du Maroc.
Si on revient au contexte effectivement français, comme je disais, cette année, j’ai pris quelques articles de presse récents parce que la littérature, mais aussi des articles de presse sont très prolixes sur le sujet. Mais rien que cette année, c’est manifeste, très fort, le ministère de la Recherche en France, le CNRS, un nombre d’organismes se disent : « mais non seulement on arrête les abonnements à certains de ces outils, pour des raisons la plus de… mais on souhaite construire. Ça y est, on s’y met ! Une logique alternative avec notamment cet outil OpenAlex qui vise à reconstruire une logique en se disant : « Bon, finalement, ça n’a pas de sens de prendre ce radar nord-américain pour analyser la production française francophone, non pas pour l’isoler du reste de la production internationale, mais parce qu’on a besoin de refixer des règles qui sont connues, qui sont les nôtres, pour poser des règles d’évaluation, ce qui forcément, et un peu le… d’une certaine façon, à la prérogative des organismes scientifiques, mais en fonction de nos critères et ne pas avoir simplement des données qui couvrent 5 et 10% de l’activité chez nous et pouvoir disposer d’un radar qui puisse capter raisonnablement bien les signaux de la recherche francophone, ce qui à l’évidence n’est pas le cas aujourd’hui de ces grands outils internationalisés.
Donc, c’est en ça que effectivement aussi la Fnege, il faut le savoir, ça c’est assez factuel, est assez contracyclique dans ce qui s’observe dans les universités françaises ou dans la recherche francophone plus largement.
Et ça pour des raisons aussi assez simples. Aujourd’hui, effectivement – comme on disait – les données ouvertes, notamment celles proposées via Crossref par les éditeurs, qui ont ouvert leurs données de citations, par exemple celles de CAIRN, mais celle aussi d’Elsevier, de Springer, de Taylor Francis, de beaucoup d’Emerald, beaucoup d’acteurs internationaux qui disent : « Bon, allez, on joue le jeu. » Effectivement, fait qu’aujourd’hui les outils open source comme OpenAlex ont une couverture beaucoup plus large et beaucoup plus, finalement, quand je disais le radar capte mieux les signaux.. ; OpenAlex a un périmètre beaucoup plus large que celui de WoS ou de Scopus avec effectivement une logique on se disant : « Bon, il y a aussi des questions de savoir qu’est-ce qu’on prend en compte, qu’est-ce que l’on prend pas en compte. » Y a des vastes débats mais en tout cas on peut capter beaucoup plus largement les signaux à partir de ce type d’outils.
Voilà, donc des alternatives existent.
L’idée bien sûr, ce matin, comme je disais, c’est pas un grand… des éléments théoriques sur le sujet, c’est fort de quelques constats et peut-être de réponse à des questions que vous pouvez avoir ou peut-être quelques précisions, nous en tant qu’observateur et en tant que opérateur technique de certaines de ces passerelles, de ces modalités, et puis aussi d’avoir un moment d’échange plus politique, plus académique ce qui, là, nous dépasse sur cette position de la Fnege qui mécaniquement en tout cas, on peut le dire sans exagérer je pense, exclu de fait une grande partie de la littérature
Francophone et réduit – bien sûr – la valeur de la production francophone, ce qui est un choix collectif très fort, on pourrait dire, dans le domaine de la gestion qui a tout le moins mérite de bien s’y arrêter.
Alors la Fnege nous dira qu’ils y ont bien réfléchi, mais je pense qu’en tout cas c’est une décision que les communautés de recherche en gestion dont ils doivent prendre la mesure pour voir ce que ça va faire dans le temps. Et c’est un choix qui tactiquement aussi peut poser beaucoup de questions, dans le sens où effectivement le fait d’embrasser ces outils de veut pas dire d’un coup être accepté par eux, puisque y a quand même des résistances extrêmement fortes comme on l’a dit très très rapidement mais qui sont factuelles. Un peu à l’intégration, forte, un peu de la production des francophones dans des ensembles qui sont, de fait, assez auto entretenant et qui sont très centrées et qui ne s’en cachent même pas sur la production nord-américaine, si on les prend telle qu’elle et brut de décoffrage.
Voilà, je ne vais pas tellement plus loin pour la dimension un petit peu… on va dire introductive de cette réunion.
L’idée, c’est pour ça qu’on avait une réunion comme ça un peu Zoom à périmètre ouvert.
C’est aussi qu’on puisse faire tourner la parole et que vous nous disiez un petit peu… Alors quand même un objectif de cette réunion, de cet échange ?
On s’était dit, mais c’est notre proposition, à vous de nous dire que l’idée était de dégager des pistes d’actions collectives. On en voit 2, 3, par rapport à ça, mais il faut qu’elles rencontrent votre intérêt, votre… Notamment, il faut savoir qu’on a peut-être un canal de communication possible et pas trop
utopique. Enfin, pas trop, je ne sais pas… Voilà, on pourrait d’une certaine façon solliciter dans la foulée de l’article qu’on a eu cet été dans Le Monde, peut être solliciter une tribune pour faire valoir en quoi y a une inquiétude – peut-être – ou que d’autres logiques d’évaluation de la recherche francophone en gestion seraient possibles en ayant une politique non pas de dénonciation mais d’interpellation un tout petit peu de la Fnege sur les conséquences en tout cas de ce qu’on est en train de faire en termes de classement. C’est une des possibilités. Est-ce que c’est souhaitable, est-ce que il faut faire ça, d’autres choses ?
Je crois savoir… Certains et certaines d’entre vous l’ont pointés aussi, que demain il y a une réunion du Comité scientifique de la Fnege donc, il y a aussi des questions de gouvernance qui sont propres à la Fnege et internes et sur lequel là nous… C’est pas notre rôle bien sûr de s’exprimer.
Voilà, alors si vous voulez bien peut-être, on peut fonctionner par mains levées pour faire circuler un peu la parole et on va essayer, le moins mal possible, moi, Pauline peut-être, de faire circuler la parole pour qu’on puisse échanger, répondre à des questions aussi sur ces sujets qui sont peuvent être assez denses. Mais si là but est moins de rentrer dans la technicité de certaines choses que d’essayer de prendre un peu l’image globale et de raisonner en termes peut-être plus politiques on pourrait dire.
00:19:07 Ulco
Thomas, je peux parler ?
00:19:10 Thomas Parisot
Oui vas-y, je t’en prie.
00:19:14 Ulco
C’est juste parce que je vais pas rester longtemps. Excusez-moi ? J’ai et juste une question, est-ce que CAIRN ne pourrait pas nous aider à… des gens à… être référencés, indexés comment on peut dire. Tout le répertoire du monde entier et des environs.
00:19:31 Thomas Parisot
Alors, effectivement, par rapport… et nous, on a une action qui est une relation relativement agnostique parce que certaines revue… mais CAIRN vous avez l’air de dire que Scopus, Web of Science, c’est peut-être pas la bonne logique, mais on aide les revues qui le souhaitent à intégrer ces corpus. On les aide comment ?
Parce que y a un certain nombre de un, en informant, deux, en apportant certains moyens matériels.
Qui sont de se dire, il faut réviser l’anglais, il faut faire un travail sur des métadonnées, sur les résumés qui vont être clés. Il faut une base de charte éthique sur lequel travailler pour pouvoir un peu se dire quelle est exactement le standard là-dessus ?
Pour donc ça, on apporte autant que possible de la matière, du temps d’accompagnement et derrière aussi, de façon très factuelle, même pour des revues qui sont très autonomes, c’est nous qui alimentons techniquement les répertoires de citations de Crossref et les métadonnées de Scopus ou du Web of Science, à partir de la base de données structurées CAIRN.
Donc on peut essayer… et faire… mais on n’est pas décisionnaire.
Et encore une fois, aujourd’hui, il y a à peu près 200 revues présentes sur Cairn qui sont indexées dans Scopus, toutes disciplines confondues. On voit que pour certaines revues, ça ne passe pas, y compris pour des raisons intrinsèques au projet de la revue.
À partir du moment ou une revue a un ancrage, par exemple professionnel, où souhaite avoir au moins une partie de son… ses numéros qui s’adressent à des professionnels de la gestion ou qui en tout cas sont des articles qui changent un peu du format absolument canonique qui vient du monde un peu biomédical et bien dans certains projets ça ne passe pas. Et là la question est plus fondamentale
en se disant : « Ah, du coup, je suis une revue en entrepreneuriat dont les articles… Il faut pas qu’on parle aux professionnels – alors ça m’embête – parce que le projet de la rue c’est justement de… à la fois une revue académique sérieuse mais aussi de faire le lien avec des pratiques dans le domaine de l’entrepreneuriat.
Donc là, quand Scopus me dit non, on n’est pas intéressé. Si la Fnege se fonde strictement là-dessus, ça veut dire que indirectement la Fnege n’est pas intéressée par des revues qui ont qui essaient de travailler leur lectorat professionnel, ce qui pose d’autres questions.
Voilà, c’est au moment où on lit directement la logique Scopus ou la logique HoS à l’évaluation des revues de gestion que, effectivement, ça dit des choses sur un académisme pur – d’une certaine façon – est extrêmement normée, qui vient de ces bases de données et qui en gros effectivement, vient du monde du biomédical. Quand on vous demande de déclarer les conflits d’intérêts dans les articles…
D’évaluer… D’avoir des évaluations à l’article extrêmement rapide de quelques semaines, c’est des tropismes, on le sait, hein ! La logique de ces outils, elle vient du monde effectivement de des sciences du vivant, avec un certain nombre d’évolutions qui se plaquent un peu tel quel, finalement sur les sciences humaines et sociales et ne changeront pas leur logique. Pour nous, ça c’est sûr.
Oui, Monsieur Berry, Michel.
00:22:02 Michel Berry
Pardon, j’ai écrit en 2004 un article dans Le Monde qui s’appelait : « il faut arrêter », il faut. La recherche en gestion doit échapper au standard américain et en expliquant la différence entre les revues américaines de l’époque qui était très académiques, souvent critiquée aux États-Unis même par le fait qu’elle soit assez coupée de la pratique, mais bon, elles sont dominantes, elles sont, elles sont connues. Et puis quelquefois la colonisation commence souvent dans la tête du colonisé avant du colonisateur. Et le pire, je sais j’allais souvent aux États-Unis à l’époque… Les gens qui font – dans les revues américaines des choses pas mal sont – mais un peu moins bien qu’eux ça les intéresse pas du tout.
Et donc c’est une quête un peu vaine de reconnaissance que de faire ça alors que, en Europe on a des institutions différentes, on a des, des modalités. Il est plus facile de faire des travaux de terrain en Europe qu’aux États-Unis parce que la, la pression de la publication est pas tout à fait la même, et cetera. Et donc se fonder sur les normes américaines pour développer – en tout cas en gestion – ca dépend des disciplines, c’est… ça me paraît absolument stupide, et je concluais l’article en disant : « C’est le scénario catastrophe, en dévalorisant les revues de terroir, c’est-à-dire européenne, ont dévalorisé par contrecoup les traditions dont elles sont les vecteurs. » Progressivement, ces recherches n’attirent plus les jeunes talents, les anciens se démotivent, les exigences se relâchent, la pollution se délite.
À quoi bon alors faire des recherches en France si on est ambitieux ?
Cette menace pèse d’ailleurs dans tous les pays européens où la tendance va à la soumission aux standards américains.
Après cet article du Monde, j’ai beaucoup de contact avec des Allemands qui disent vous avez raison. C’est un problème.
Donc le scénario peut être évité si on sait valoriser ce qu’on fait en Europe.
Et moi j’avais, j’avais beaucoup apprécié l’article du Monde. Je disais : « Tiens ! Sur CAIRN, je le sais, j’ai fait beaucoup de monde. CAIRN INFO voilà, voilà un support qui peut nous permettre d’éviter le pire. Ça veut pas dire qu’il faut se désintéresser ce qu’est fait aux États-Unis, mais éviter le pire, c’est à dire repérer des singularités, des originalités – françaises où européennes – qui intéresseront les Américains eux-mêmes.
00:24:25 Thomas Parisot
Absolument.
00:24:26 Michel Berry
Et c’est pour ça que quand j’ai vu votre message sur les classements, je lui dis : « Ouh là là ! Si CAIRN adopte la position de la Fnege, on est mal parti ! » Je ne comprends pas la position de la Fnege qui me semble stratégiquement très faible.
00:24:38 Thomas Parisot
On est d’accord ? En tout cas pour clarifier, si nous on devait avoir une position, c’est que… d’autant plus qu’elle est poussée… Michel, on pourrait rajouter à ce constat de 2004 la poussée maintenant très forte de la production francophone du Sud, si je puis dire.
Qui fait que ce qui est vrai en France est a fortiori vrai au Maroc, en Sénégal et ainsi de suite… et que la taille critique – le problème n’est pas français, le problème est francophone – et effectivement, et que on peut se dire que pour le coup, il y a une taille critique tout à fait louable qui encore une fois sont d’ailleurs aussi l’intérêt de ces outils d’analyse qui sont plus preneurs de voir émerger l’originalité de cette recherche pour repérer des points de…
00:25:13 Michel Berry
Ouais.
00:25:14 Thomas Parisot
Qui, voilà, créatifs, originaux, intéressants à l’échelle internationale, plutôt que de voir simplement assimiler toute une production à ce qui est déjà en place en Amérique du Nord.
00:25:23 Michel Berry
Juste un mot, je donne des… Je suis… On a partenariat à l’école de… avec l’université Mohammed IV Polytechnique au Maroc, qui a créé une école d’ingénieurs où on fait des cours et une école de commerce et on voit bien dans cette école qu’il y a une tension entre la… les publications américaines et le parler américain dans les enseignements, alors que la plupart des étudiants et des profs sont plus à l’aise en Français. Et que.
Ils sont… Ils sont un peu… Ils savent qu’il faut faire quelque chose pour être reconnu aux États-Unis, mais ils sont très intéressés de ce qui peut venir de France et c’est vraiment…. Ce serait vraiment stupide de ne pas de ne pas se défendre. Et c’est pour ça je vous dis : « Moi l’article du Monde sur CAIRN, je lui dit Ah ça… C’est chouette. ».
00:26:06 Thomas Parisot
Exactement. CAIRN va devenir un… peut devenir un instrument pour éviter pour éviter de s’ajuster bêtement sur les stratégies sans ambition.
00:26:19 Thomas Parisot
Tout à fait. Et comme dans toute crise, il y a des opportunités. C’est peut-être l’occasion de se dire bon, plutôt que voir absolument changer ça, y a aussi l’idée de faire des propositions. À un moment, ces classements… ces propositions, elles viennent du fait, ce qui était un peu notre optique, le début.
Mais encore une fois, ça n’a de sens que si la communauté des revues francophones est intéressée, bien sûr.
Aurélien, vous voulez aussi rebondir sur ces sujets ?
00:26:41 Aurélien Rouquet
Oui, merci Thomas pour cette réunion et bonjour à tout le monde. Je pense que… voilà… bon tout le monde connaît mon point de vue sur les classements et l’importance de défendre une pensée francophone. Mais, je pense que pour imaginer les intérêts il faut aussi comprendre la position de la Fnege et en fait pour moi la position de la Fnege elle s’explique essentiellement par… en fait, quel est le public de la Fnege. Le public de la Fnege c’est à la fois les universités – dans lequel il y a un système d’évaluation de la recherche, qui est ce qu’il est… voilà – et c’est des écoles de commerce. Et aujourd’hui dans les écoles de commerce et – je suis bien placé pour en parler puisque j’y travaille – le seul système, aujourd’hui, qui est évaluer pour la recherche, ce sont les classements de revue, c’est vraiment le truc qui structure absolument les promotions, les primes, et caetera. Et les écoles de commerce françaises, les HEC c’est encore plus loin que nous chez Neoma, mais on a aujourd’hui un corps professoral qui est très largement international. Donc, la position de la Fnege, elle est aussi par rapport à ce public-là qui réclame un outil. Qui va lui permettre, entre guillemets, d’évaluer son corps professoral.
Et je pense que c’est cette tension-là qui explique le choix de la Fnege, que je regrette, mais qu’il faut comprendre dans, à mon avis, toute initiative qu’on voudrait avoir pour faire évoluer les choses. C’est-à-dire que c’est… Je suis pas en train de défendre le point de vue la Fnege.
00:28:07 Thomas Parisot
Bon, je comprends bien.
00:28:10 Aurélien Rouquet
Je suis en train de dire que voilà le point clé qui explique le positionnement et ce que ce que dit Jérôme Caby quand il parle des classements s’est dit : « Bah oui. Le rôle de la Fnege, c’est de classer des revues francophones. Voilà. Pas aussi bien qu’un rang 1, mais ça permet qu’elles existent dans les systèmes d’évaluation des écoles de commerce et elles n’existeraient pas effectivement s’il n’y avait pas le classement de la Fnege par ce que l’on prendrait le classement ABS et il n’y aurait plus la Revue Française de Gestion, Gérer et Comprendre, toutes les revue qui sont autour de la table, voilà.
Mais c’est le contexte que je voulais juste….
00:28:40 Thomas Parisot
Mais on doit être conscient de ça, c’est-à-dire que nous pour avoir participé un peu, beaucoup, et assisté à beaucoup, beaucoup de débats là-dessus, y compris dans des contextes très loin de la France ou en Amérique du Nord où c’est tout autant dénoncé, c’est la question de la proposition.
C’est-à-dire qu’on est tous d’accord. Il y a un consensus. Même les gens du Web of Science sont là en disant : « Écoutez, on est d’accord de la limite et surtout de l’utilisation qui est un peu… des dérivés d’utilisation qui peut être fait des métriques qu’on peut produire. »
Mais qu’est-ce qu’on fait ? Quelle est l’alternative ?
Et effectivement… alors ce qui est nouveau dans le moment actuel – et là où on pourrait peser – c’est dans la façon de proposer des alternatives et là effectivement, la plupart du temps, ça se heurte à des questions opérationnelles, techniques.
Mais c’était aussi un peu la préparation de cette tribune dans Le Monde qui était un peu préparatoire, en disant : « Bon pour CAIRN aujourd’hui – et on a commencé à y travailler – Il y a une façon de pouvoir dire, établissement par établissement. Vous êtes Neoma. On peut vous donner des éléments d’impact de ce qui se passe avec les articles et les auteurs de Neoma.
Pourquoi ? Parce qu’une filiation technique est faite, on sait que Aurélien Rouquet a publié tel article. Qu’il y a tant de citations, tant de trafic et on sait qu’il est affilié à Neoma. Donc, on peut inverser le processus pour dire : « Voilà, sur la production de Neoma qu’on voit : quel est l’impact, quelle est la circulation internationale, quelles sont des revues qu’on peut… » Et avec un point de vue évidemment sur cette énorme… on pourrait dire « boule à facettes de la recherche mondiale » qui est un point de vue forcément partiel mais comme l’est Web of Science ou Scopus et qui, en tout cas, à tout le moins, permet d’hybrider les logiques, non pas pour dire on fait un classement alternatif des revues, mais quand même pour se dire : « Bon, comme tout classement est ce qui confirme, est- ce qui corrobore ce que, effectivement, je vois dans les classements américains où est-ce que pour le coup c’est complètement inverse. Ne serait-ce que… est-ce que l’on a un problème de zoom ? Aujourd’hui, la cinquantaine de revues de gestion qui sont dans ces outils américains, ils sont écrasés par – d’une certaine façon – les métriques qu’ils obtiennent au sein de ces outils sont très… sont très biaisées parce que… ils sont écrasés par des tropismes en disant : « Tiens, on a fait un ou deux articles à en marketing un peu à l’américaine d’un coup ils ont un peu plus de citations et comme on est tous dans l’épaisseur du trait du fond de ces classements, ça peut permettre à une revue de française d’être deux fois plus importantes en impact qu’une autre.
Est-ce que ça veut dire que ces travaux sont deux fois plus importants ? Non, ça veut dire que la variation qu’on voit, elle est – pour un statisticien – non significative.
Elle est effectivement dans l’épaisseur du trait, si je puis dire. Alors que si on zoomait et qu’on avait une masse critique un peu plus importante de données sur la revue française, ça permettrait de voir les phénomènes dans toute leur ampleur, dans toutes leurs dimensions.
Donc, effectivement, on doit aller non pas, quand je dis « alternatif », c’est peut-être aussi « complément ». C’est aussi, d’une certaine façon, de prôner une logique un peu complémentaire et d’hybrider certains constats, parfois un peu mécaniques, hein… Cette revue est à l’évidence plus importante que tel autre, avec un autre outil d’observation d’analyse.
Aurélien, vous voulez rebondir ?
00:31:20 Aurélien Rouquet
Et juste pour compléter, ce qui me semble très important, c’est l’idée aussi de d’évaluer, entre guillemets, un impact local et territorial. C’est-à-dire que… c’est ces classements et ces mesures d’impact, elles évaluent uniquement en gros est-ce qu’on est cité par des autres revues anglo-saxonnes, mais est-ce que on est lu par les étudiants ? Est-ce que on est repris par les entreprises ?
Enfin voilà… Cette question de montrer aussi… qu’on a un impact sur notre territoire francophone et qu’il est important. C’est aussi quelque chose qui n’est pas du tout pris en compte par ces classements.
Peut-être aussi quelque chose… Voilà… À intégrer, à imaginer dans la réflexion.
00:31:59 Thomas Parisot
Non, parce que là, l’impact derrière cette notion qu’on a tendance à essayer de mettre un peu comme un absolu, Il y a la question : « C’est pour qui ? ». Mais effectivement, comme les cibles des revues sont multiples, peut-être même, et ça c’est la question de la finalité de la Fnege, c’est-à-dire que c’est la vision qui est celle de la Fnege. Il nous semble, pour ce qu’on a entendu un peu, que : y a des contradictions aujourd’hui !
Dans la Fnege, peut être, affiche un certain volontarisme vis-à-vis de la transmission de la recherche en gestion auprès des entreprises – ce qui va être le cas des grandes écoles aussi – ça c’est contradictoire avec un alignement complet avec des logiques à la Scopus, Web of Science qui sont complètement décorrélées d’une vie, d’une vie économique locale. Ça c’est sûr.
Donc, c’est aussi faire des… peut-être… des suggestions sous un angle parfois positif, en disant, à tout le mois – pour certains axes de la stratégie de valorisation de la recherche francophone en gestion – enfin de la recherche en gestion – laissons le francophone. Eh bien, la notion de ces grands outils Américains vont mesurer l’impact auprès des chercheurs internationalisés anglophones.
Et ça, c’est une partie de la cible, mais ce n’est pas toute la cible.
Oui, Michel.
00:32:54 Michel Berry
Est-ce qu’on peut, est-ce qu’on peut lancer l’idée du fait qu’il y a plusieurs critères d’évaluation, que l’évaluation c’est pas un seul critère, ça peut être L’évaluation multicritères. Et Parmi ces critères, il y en a d’autres que CAIRN peut permettre de documenter.
00:33:10 Thomas Parisot
Absolument. Alors après… on est dans un contexte presque d’urgence parce que on aurait on peut avoir cette discussion tout à fait sereinement en disant : « On pourrait construire de façon intelligente un nouveau classement 2025, un peu plus équilibré avec un outil CAIRN sur base OpenAlex, avec des données qu’on structure pour avoir des interfaces rapidement prêtes à l’emploi et parallèlement à ce qu’on observe sur le Web of Science et Scopus qui existent et c’est pas l’idée de nier quoi que ce soit.
Le problème étant l’urgence relative dans lequel nous-mêmes, me semble t-il, la position actuelle du classement de la FNEGE qui est de se dire : « Bon, plus de débat, on arrête de tourner autour du pot, ce qu’on fait depuis longtemps certes, mais en absence de solution, je préfère prendre une position extrême que de rentrer dans la complexité d’un hybride qu’il va falloir constituer. »
Mais effectivement, ça, je vous laisse juge de ce qui est possible. Mais ça appellerait plutôt un peu plus de temps long, si je puis dire. Au sens où l’idéal ça serait de constituer un groupe de travail.
Monsieur bretonnes candidatait dans le tchat, j’ai cru voir, et je pense beaucoup d’autres d’entre vous seraient partants pour se dire mais attendez ça on pourra en discuter et c’est pas à CAIRN qui est un opérateur d’en discuter. Ça peut être des responsables de revues et un comité de nature plus scientifique qui peut essayer de construire… voilà… à partir des possibilités techniques, des optiques multicritères les moins mauvaises possible pour dire des choses, d’autres types de lectorat professionnels, étudiants en France, en Afrique, en Amérique.
Bon, et à travers des traductions en anglais pour essayer de faire des zooms, simplement apporter de la connaissance un peu plus précise que ces outils américains qui encore une fois donnent une image extrêmement impressionniste de la recherche francophone, puisque vous êtes vraiment en bordure. Si on était là, c’est le petit pixel en coin de l’écran, hein, vraiment !
Et ça, c’est un peu dangereux de construire des analyses sur des données qui sont de fait très faibles, très peu importantes, très peu d’articles en compte et surtout très peu de citations dans les rues américaines, donc peu de matière d’analyse finalement.
00:34:51 Michel Berry
Oui, juste un mot et juger des professeurs, seulement sur ce critère, n’est pas une bonne chose pour les rapprocher des étudiants. Parce que moi j’avais une fille qui a fait, qui a fait un cours d’une grande école de commerce et j’ai compris, quand c’est un prof qui publie, je ne vais pas à son cours. Il ne m’intéresse pas. J’en ai d’autres qui sont moins connus. C’est potentiellement catastrophique, je trouve. Surtout qu’une école de commerce française recrute des jeunes, c’est pas comme aux États-Unis, ils sont pas encore mûrs, donc le rôle de l’encadrement est extrêmement important. Donc, un enseignement publiant qui publie sur les choses abstraites dans des revues… que aucun de ces jeunes ne lira – sauf miracle – est pas bien connecté à l’enseignement.
00:35:34 Thomas Parisot
Ouais, tout à fait d’accord.
00:34:35 Michel Berry
… et en plus ceux qui font… ceux qui assurent les cours des écoles de commerce sont moins valorisés que ceux qui publient, donc ils sont moins payés. Donc, bref, c’est un porte à faux.
Bon, ça c’est bien. C’est pas facile, mais là absolument. Mais il y a un paradoxe, absolument.
Y a un paradoxe, oui. Un paradoxe absolument terrible.
C’est drôle parce que j’ai écrit… J’ai annoncé la catastrophe il y a très longtemps. Elle se produit. Et que jJ’ai vu que des chercheurs que j’ai… qui ont beaucoup apprécié… ce que… une technologie invisible se sont fait prendre dedans.
J’avais scientifiquement raison, mais j’aurais préféré avoir tort. Voilà.
00:36:10 Thomas Parisot
Et effectivement, on le sait. Et Jean-Philippe qui lève la main – ça ne m’étonne pas parce que j’allais le citer – il y a un paradoxe fondamental qui est celui du fonctionnement parfois de l’évaluation des écoles, qui s’appuient sur la recherche.
Alors ce ue vous pointiez Michel, c’est pas effectivement un critère forcément de qualité de l’enseignement pour des étudiants par exemple.
00:36:26 Michel Berry
Dans la recherche américaine, parce que OK.
00:36:27 Thomas Parisot
De la recherche américaine. Effectivement, ouais. Tout à fait.
Jean-Philippe, tu voulais réagir aussi ?
00:36:34 Jean-Philippe Denis
Oui, Bonjour. Bonjour, Bonjour, merci. Merci d’abord pour cette réunion qui me paraît extrêmement importante. Moi j’ai, moi j’ai trois points, trois points à soulever. Alors j’ai suivi ces débats d’assez loin, n’étant plus en responsabilité d’une revue.
Mais j’ai suivi ces débats d’assez loin et je note trois éléments au vu de ce qui a été dit.
D’abord, c’est le côté totalement contra cyclique de la décision de la Fnege.
C’est-à-dire. On est dans un monde qui se fragmente. On est dans un monde ou les tensions internationales n’ont jamais été aussi vives.
Et la Fnege continue à raisonner dans le paradigme que j’ai appelé du « Hight Cost » et en espérant la « Hight Value ». C’est-à-dire un paradigme de la globalisation où finalement, on pourra aller vers le tout anglais. Et on a démonté ça à d’innombrables reprises, y compris dans une étude de la Fnege, donc voilà, et des effets délétères que ça pouvait avoir. Donc, c’est le premier point, c’est le côté contracyclique.
Outre, d’ailleurs, ce qu’on avait déjà produit nous aussi dans Le Monde sur la recherche francophone… n’a aucune raison de se soumettre à l’ordre anglo-saxon.
Bon, donc ça veut dire qu’on est face à une vraie rigidité politique et qui peut nous envoyer dans le mur ! Vraiment.
Je pense que c’est y a un moment où il faut mettre les mots et ça peut nous envoyer dans le mur.
Le deuxième élément, c’est la réaction d’Aurélien sur les écoles. Je pense qu’aujourd’hui, quand même, ce que tu n’as pas précisé Aurélien, c’est que tout ça est financé sur le dos des familles et des étudiants.
Cette explosion des coûts de formation et des frais de scolarité dans les écoles et que là, il y a un vrai débat démocratique ?
Alors d’abord, est-ce que les universités doivent s’imposer la logique des écoles ? Ça, c’est un vrai sujet.
La Fnege étant censée représenter l’ensemble des parties prenantes. Elle peut pas prendre des décisions au nom que d’une partie prenante et des besoinsd’une partie prenante.
Mais au-delà de ça, on sait très bien qu’on est dans un univers qui est globalement, vous allez dire presque une, enfin, je veux dire d’une hypocrisie sans nom, parce que l’essentiel des étudiants restent des étudiants français dans les écoles.
Si je neutralisé la question des professeurs.
Deuxième point, les écoles font des formations exécutives. Les entreprises qui sont consommatrices, clientes de ces formations exécutives sont majoritairement, très majoritairement, dans le contexte français… et francophones.
Et donc, résultat des courses, pour alimenter une course au classement du Financial Times et autres… et la liste Fifty-Fifty et tout ça. Et ben, on fait supporter ce coût sur des étudiants dont les frais de scolarité explosent, c’est-à-dire que : on justifie ça au nom de l’excellence de la… et caetera, et cetera.
Mais on sait très bien que ceux qui en supportent le coût, n’en tirent aucun bénéfice. À part un classement le plus élevé possible de son institution dans des classements. Donc, ça pose la question de ces classements. Mais ça, je pense que c’est un vrai débat, presque citoyen et démocratique.
On a vu les effets de ce genre de choses aux États-Unis avec l’explosion de la dette des étudiants qui aujourd’hui s’interrogent énormément.
Le MIT vient d’annoncer des mesures très fortes, c’est-à-dire qu’à moins de 200.000 Dollars annuel du foyer fiscal, les étudiants ne paieront plus de frais de scolarité. Donc y a un vrai débat derrière qui est complètement neutralisé derrière tout ça, c’est-à-dire qu’en fait ça, ça permet des jeux d’images, mais ça n’a rien à voir avec la science. Voilà, ça n’a rien à voir avec la science. Et ça, à un moment, il faudra bien que ce débat sorte. Parce que, de fait, la Fnege devient complice de ça. Voilà ! De cette explosion des frais de scolarité des écoles et de ce système.
Puis, le troisième point. Donc après la dimension contracyclique et les écoles, c’est quand même qui classe ? Qui classe ?
Et là, je suis désolé, mais il y a un collège scientifique des associations académiques qui classe ses propres revues. Ce n’est pas supportable. Ce n’est pas admissible. À un moment, il faut que des acteurs tiers classent. Faut que des acteurs, qui ne soient pas juges et parties du jeu, procèdent à ces classements.
On a eu le même problème avec la liste CNRS, exactement le même problème. Elle a disparu !
Donc, à un moment, il faut… Moi, j’ai toujours défendu l’idée que… Je ne sais pas s’il faut abandonner les classements, mais – à minima – avoir une liste de revues reconnues, labellisées, qui permet de dire ça, ça vaut quelque chose.
Ensuite, le problème c’est la hiérarchisation. Et c’est la hiérarchisation qui nous enferme complètement dans ces logiques de domination, de soumission, de tout ce qu’on veut. Sans parler du fait que beaucoup considèrent qu’il devrait même pas y avoir de classement francophone.
Donc en fait, c’est ça le débat derrière, c’est la disparition des classements francophones.
Et ça, je pense que poser cette problème de qui juge, qui classe et peut-on classer quand on est juge et partie ?
Je suis désolé, on ne peut pas classer, c’est un problème d’éthique scientifique élémentaire.
On ne peut pas classer quand on est soi-même juge partie.
Ce n’est pas possible et donc, partant de là, on a une sorte à la fois de dimension d’erreur stratégique – mais absolument majeure parce qu’on ne voit pas le monde qui change. On alimente des dynamiques qui à la fin pèsent sur le citoyen, sur le contribuable, sur l’étudiant, sur tout ce qu’on veut… qui deviennent complètement folles, mais vraiment complètement folles.
On n’est pas loin, nous avions eu une séance comme ça avec Franck Aguerri en disant, en fait, on est dans un monde de subprimes académiques. Voilà, une sorte de crise des subprimes académique, ce qu’on produit de plus en plus de papier que personne ne lit. Donc, en fait, c’est comme les maisons où personne n’habite. Voilà, c’est ça la logique des subprimes ?
Donc, on a la même logique. Une logique financière qui est complètement folle mais qui pèse très concrètement sur les épaules des étudiants qui assument les frais de scolarité et le dernier point, c’est, c’est c’est.
Est-ce qu’on peut classer quand on est jugé parti ?
Pour moi, on ne peut pas classer quand on est juge et partie. Il nous faut des acteurs tiers, et je pense que CAIRN peut être cet acteur tiers, parce que CAIRN n’a pas d’intérêt, n’a pas d’intérêt, ce qui n’est pas le cas, ce qui n’est pas le cas parfois de ceux qui classent, voilà.
00:42:35 Thomas Parisot
Laurent voulais aussi rebondir et alimenter peut être aussi cette réflexion collective.
00:42:42 Laurent Cappelletti
Oui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis en phase avec les premiers propos tenus hein ? Notamment de Michel et Jean-Philippe évidemment.
Mais juste trois points.
Donc, le premier c’est… en fait dans un monde idéal, ce serait bien s’il n’y avait pas de classement mais les classements comme c’est… On a l’impression que c’est une activité humaine de base quoi. Donc voilà, il faut classer, évaluer. Donc si on s’en occupe pas nous-mêmes, toute façon on aura toujours qui en feront… mal. Donc en fait… Il n’y a pas le choix à mon avis.
Deuxième point, c’est, effectivement, il y a une place aujourd’hui et CAIRN peut tout à fait le jouer. C’est pour ça que j’avais réagi très positivement à ce que vous avez fait avec d’autres collègues, dont dont Jean-Philippe, des classements, en fait on parle d’impact, mais c’est des impacts consanguins en fait. Donc pourquoi pas, c’est des impacts intra communauté mais c’est pas du tout, ça mesure pas du tout… d’impact société, soit la société où un tant soit peu exogène et en y réfléchissant le nombre de
Consultations, effectivement, avec la source de « qui consulte », hein. Étudiants, universitaires, journalistes, législateurs, on a un certain nombre à être régulièrement sollicités sur des lois, et caetera.
Et en fait, on leur envoie, on leur envoie nos travaux, quoi ! Ils les ont consultés. Bon, voilà, et caetera, et caetera.
Ça me semble vraiment la voie à prendre et le troisième point c’est d’un point de vue plus politique, le fait que, effectivement, même si on a des vocations à être internationalisés, l’espace francophone, c’est un… C’est vraiment un domaine à prendre. Y a énormément de demandes de… pour ceux qui vont régulièrement dans les pays des universités, des écoles, des entreprises, de l’espace francophone.
Là encore, si l’on s’en occupe pas nous, d’autres…. Euh, il suffit de voir même au plan académique, hein. La présence turque, russe, chinoise, qui… qui prend les trous où on est pas quoi, hein ?
Donc, voilà hein. Donc, pour ces trois dimensions, oui après bon bah débattons sur la forme et caetera.
Mais je pense que ce qui a été fait, c’est franchement, je, je, je.
Il me semble que c’est, c’est, c’est. C’est déjà un coût, quasiment, de maître quoi !
00:45:25 Thomas Parisot
Et encore une fois, on précisera des questions techniques, mais la technologie peut un ensemble de choses.
C’est là où il faut remettre sur la table pour regarder ce qu’on veut faire.
Mais par exemple, Laurent, ce que vous pointiez… Analyser, nous on a commencé à… nous à faire des tests, d’analyser le nombre de citations ou de mentions des travaux académiques dans les rapports de la vie publique francophone en France, en Belgique, en Suisse.
00:45:40 Laurent Cappelletti
Hum, hum.
00:45:42 Thomas Parisot
C’est quelque chose qui demande… et qui est forcément un travail local. C’est un peu pareil pour la presse. La traçabilité dans la presse
Les métriques américaines, vous dire : « Vous n’avez pas de mention dans le Washington Post dans contrôle-comptabilité-audit. »
Mais ça ne veut rien dire. Il faut assumer le caractère local, comme on disait territorial, les terroirs. Je comme disait Michel.
00:46:00 Laurent Cappelletti
Exactement.
00:46:02 Thomas Parisot
Mais en se disant : « On va voir s’il y a de l’impact dans la presse professionnelle en gestion, dans Le Monde, dans Le Figaro, dans… et effectivement avec des périmètres… et il paraît sur les rapports en disant : « Bon, avoir influencé un rapport de la Cour des comptes en France ». Ça n’apparaît pas dans les rapports américains, mais c’est la finalité de certains travaux francophones.
00:46:17 Laurent Cappelletti
Exactement, exactement, exactement. Dans la PQR, hein.
On a un certain nombre. Voilà les travaux cités dans Midi Libre, Ouest France. Là, on est vraiment sur de l’impact.
00:46:32 Thomas Parisot
Et ca, techniquement, c’est possible. Aujourd’hui, on n’a jamais été aussi bien équipé pour le faire.
00:46:33 Laurent Cappelletti
Un pacte, quoi.
00:46:34 Thomas Parisot
Encore faut-il vouloir le faire et surtout l’organiser pour que les… bah…Le mettre en visibilité progressivement, hein. Il y a une certaine progressivité dans ce qu’on évoque.
Ça va pas être le grand soir évidemment, mais c’est déjà de s’engager dans une forme de proposition, hein. Là-dessus…
Benjamin, tu voulais aussi rebondir ?
Et puis après je vois que Michel aussi à relevé la main. Vas-y Benjamin.
00:46:54 Benjamin Cahen
Merci Allô.
Et… J’essaie de contribuer en disant deux choses.
La première, je pense que c’est une évidence pour tout le monde mais ça va aussi bien en étant dit : la question sur les classements est qui nous classent dépasse là le domaine de la gestion. C’est un sujet qui est d’actualité pour toutes les sciences, dans toutes les publications scientifiques, qu’il s’agisse de médecine, de recherche. Enfin, voilà donc. En médecine, on a qui est un domaine que je connais bien, on a le problème des points Sigaps, c’est effectivement… Il y a derrière tout cela, donc, une question de financement des institutions, des auteurs et de prise en compte de leurs publications pour leurs publications pour leurs carrières.
Donc, c’est un sujet qui est vraiment global et qui touche – finalement – toutes les publications scientifiques.
La deuxième chose que je voudrais dire – et là je me fais l’avocat du diable et pardon, je veux pas jeter un pavé dans la mare mais je vous entends depuis tout à l’heure dire… et je suis pas contre, hein.
Bien au contraire, j’ai des relations très amicales avec CAIRN, que ce serait bien que CAIRN s’occupe de faire ce classement-là – mais attention, d’un point de vue extérieur CAINR un peut aussi être considéré comme étant juge et partis, ou en tout cas – si ce n’est pas le cas – je viens que Thomas me le confirme, mais CAIRN est une entreprise commerciale, même si c’est une société à mission qui vend des abonnements et donc faire porter par CAIRN le classement des publications qui se retrouvent dans CAIRN, c’est peut-être un biais auquel il faut penser avant de se lancer dans l’aventure.
00:48:36 Thomas Parisot
Et nous, on n’a aucune velléité là-dessus. Parce que, enfin… Je veux dire, effectivement, Benjamin pose la bonne question de la légitimité de ce qu’on va produire, comment la maximiser ? Comment… ? Si demain l’idée c’est de faire une proposition à la Fnege en disant : « Vous savez. On est des gens gentils et participants, hein. On représente les revues francophones, en tout cas qu’on diffuse, on essaye…
Et sans être parfaitement, voilà bien sûr, c’est une parole collective donc, mais… mais, par contre, on peut mettre des outils sur la table qui permettraient à la Fnege par exemple, de mieux travailler.
Alors, si la Fnege ne veut pas s’en saisir, il peut y avoir constitution d’une sorte de collectif, hein, si ça doit être une association ou à une structure qui vous paraît très pertinente, qui se disent : « Il faut décorréler complètement la logique vente d’abonnements et diffusion des connaissances. D’ailleurs, au passage des livres qui sont largement niés dans les classements américains, voilà donc… Parce que ça pose aussi la question de la négation de la production de livres, hein, cette histoire d’alignement sur Scopus, bon. C’est déjà le cas dans le classement de revue mais on veut, on peut participer au fait de réouvrir le sujet en disant : « Bon. Arrêtons de dire qu’un livre n’a aucune forme de connexion avec la vie académique.
Peut-être ça, ça pourrait aider à avoir une image un peu plus représentative.
Mais Benjamin à raison de se dire, nous on est ouvert à toute forme de gouvernance et de structure qui fait que, au-delà de la capacité opérationnelle des datas, des… où nous on peut en dans notre mission, si je peux dire, mettre sur la table des outils en disant : « Ben nous, on veut bien faire le travail. »
Après, effectivement, où est ce que se passe la prise de décision de pilotage de l’ensemble ? C’est pas forcément nous, hein ? On est, on est bien d’accord, Benjamin !
Alors il y avait – dans l’ordre – je crois Michel, Aline et après Véronique.
00:49:58 Michel Berry
Alors j’espère que dans marteau-piqueur va se calmer, mais ça, ça, vous l’entendez le marteau piqueur.
Non, non. Bon, Pourquoi faire des classements ? C’est pas obligé.
C’est si vous avez des indicateurs d’impact de… auprès des étudiants de… vous pouvez les… simplement les diffuser.
Alors là, la question c’était, est-ce que vous diffuserez publiquement où est-ce que vous diffuseriez aux revues ? Par exemple, moi, je sais que souvent on regarde nos indicateurs, on regarde nos synthétiques sur.
00:50:24 Thomas Parisot
Une des questions ?
00:50:29 Michel Berry
Sur nos rêves et on peut les… les invoquer à des interlocuteurs. Si par exemple, pour le journal de l’École de Paris, on parle avec des entrepreneurs, voilà, y a tel genre d’articles, y a tant de citations. C’est-à-dire que finalement les revues sont dans un environnement variés et elles peuvent utiliser des paramètres que vous mesurez selon l’environnement…
Ça débouche pas forcément sur un classement, ça débouche sur des… de la mise en évidence d’un certain nombre de paramètres d’impact différents de ce qu’on mesure dans le classement dominant.
Bon, je coupe parce que mon marteau piqueur reprend du… de la force.
00:51:13 Thomas Parisot
Et donc, il y avait aussi Aline qui voulais rebondir aussi sur ce qu’on ce qu’on évoquait.
00:51:18 Aline Scouarnec
Oui merci, merci Thomas. Bonjour à toutes et tous. Je partage tout ce qui a été dit bien entendu.
Moi je pense que finalement, au travers de tout ce qu’on est en train d’évoquer, ce qui manque finalement aujourd’hui en France, dans la communauté en tout cas – en particulier en sciences de gestion et du management – c’est finalement une stratégie nationale.
Qu’est-ce qu’on veut réellement ?
Et donc je pense que, avant de parler de classement, il faudrait déjà que… qu’on se mette d’accord, ensemble. Et là, je trouve qu’on forme une belle communauté – peut-être pas exhaustive – mais en tout cas déjà une belle représentation. De se dire : « Mais, finalement, qu’est-ce qu’on veut réellement valoriser au travers de nos recherches aujourd’hui ? »
Nos recherches doivent parler comment… à l’ensemble de la société, que ce soit le citoyen lambda, que ce soit que ce soit l’étudiant, que ce soit l’entreprise.
Enfin, voilà donc je pense qu’il faudrait qu’on se mette d’accord sur ça pour et ensuite au travers. Moi, j’ai été bluffée quand Thomas m’a présenté toutes les statistiques qui sont aujourd’hui consultables tous les jours, les tableaux de bord qu’on peut avoir au travers de CAIRN. Je pense que vous êtes les seuls aujourd’hui à avoir toutes ces données… et on est quand même aujourd’hui dans un monde des datas où je pense qu’il faudrait faire parler et valoriser ces chiffres et pas forcément au travers d’un classement.
Chacun peut avoir des spécificités en fonction… et puis on peut avoir peut-être vous aider, même peut-être sur des tris que nous on aimerait encore plus fins, peut-être sur certains sujets
00:52:48 Thomas Parisot
Absolument.
00:52:54 Aline Scouarnec
… pour pouvoir les valoriser nous-mêmes et donc je pense que ce sujet est vraiment important.
Après, sur ce qui a été dit sur le classement et la consanguinité au sein de la Fnege… Moi, ce qui me pose problème au-delà de cette consanguinité, c’est aussi que on sait tous mis d’accord – plus ou moins – parce qu’on a tous participé directement, indirectement sur les nouveaux critères, mais que, finalement, la qualité d’évaluation pour avoir participé depuis un certain nombre d’années à tous ces classements. On est quand même sur des données qui restent déclaratives.
Et donc la qualité des données qui sont… Bah voilà ! On fait confiance à tous les collègues, mais on peut se poser parfois aussi des questions alors que CAIRN a vraiment des données de consultation qui sont vraiment pour moi beaucoup plus pertinentes et donc se pose la question de… est-ce que est-ce que on accepté de jouer le jeu 2025 du classement Fnege ?
Est-ce qu’on s’engage dans une… dans la rédaction d’une stratégie nationale ?
Voilà, qu’est-ce qu’on fait ? Mais je pense qu’on est vraiment et Jean Philippe l’a bien dit.
On est à un moment de l’histoire où on voit bien quand on regarde ce qui se passe au niveau géopolitique, géostratégique, quand on voit les jeux d’acteurs et quand on voit les… toutes ces problématiques, on se dit mais finalement est ce que on n’est pas encore en train – alors qu’on est censé être des chercheurs d’avant-garde – dans le monde d’hier avec ces logiques.
Donc, moi je suis ouverte en tout cas à toutes ces propositions, mais très engagée, en tout cas pour faire bouger les lignes.
00:54:17 Thomas Parisot
Entendu et merci beaucoup.
Ouais Véronique, je prends dans l’ordre un peu des levées de mains que.
00:54:22 Véronique Zardet
Merci euh. Bon tout d’abord ce que je voudrais dire c’est que l’un de nos collègues disait que nous ne sommes pas les seuls à avoir un classement. Mais je voudrais quand même signaler le contre-exemple des juristes hein, qui sont très forts, qui n’ont aucun classement.
Et je vous assure que, quand on est dans une université où les juristes sont particulièrement dominants, au moment des attributions des primes RIPPEC ou autres, ceci pèsent dans la balance en défaveur des collègues en gestion, puisque les classements sont aussi utilisés – notamment – par le CNU Sciences de gestion au moment de la classification des dossiers.
Je voudrais témoigner du fait que je remercie CAIRN qui nous a beaucoup aidé pour notre classement Scopus.
Ça a été relativement aisé grâce à un travail préparatoire de forme, beaucoup de formes, purement de formes, la qualité des comptes rendus, la régularité de publication et ceatera.
Et vous dire que j’avais été particulièrement scotchée par une des recommandations de Scopus qui nous a tout de suite donné une évaluation favorable en nous disant, il faudrait davantage – dans les citations des articles – que des revues citées parce Scopus soient citées dans les publications.
00:55:46 Thomas Parisot
Voilà, c’est dit, c’est encore plus explicite comme ça.
00:55:47 Véronique Zardet
Ça a été dit très clairement et on a notre message écrit qui nous dit ça, hein !
Faites un effort auprès de vos auteurs pour qu’ils citent davantage les revues référencées dans Scopus.
Et puis je voudrais dire que moi, à titre personnel, je suis vraiment favorable à la proposition de Jean-Philippe qui est de dire plutôt une liste de référence qu’un classement qui est… qui est source de nombreux jeux d’acteurs où, effectivement, on va plus à la course aux étoiles qu’à s’intéresser à l’intérêt de ce qu’on écrit ?
Et puis dernier point, c’est quand même la responsabilité du collège scientifique de la Fnege, c’est-à-dire que – entre les rédacteurs en chef des revues, vous savez très bien qu’on est tous croisés – c’est-à-dire que soit une association à une revue, soit une association à plusieurs revues sur lesquelles elle s’appuie.
Nous devons, je pense, être davantage courageux dans le collège scientifique de la Fnege et les présidents ou ceux qui représentent les présidents dans les deux réunions annuelles du collège scientifique. Il faut qu’on porte plus clairement et se malaise fort, même si ensuite le jeu est biaisé par… On a deux parcours, hein !
On a la commission des revues francophones et des anglophones et on sait qu’on a un certain nombre de collègues qui sont, voilà, particulièrement attachés au classement anglophone puisqu’il n’écrivent qu’en anglais, mais ce n’est pas l’ensemble de communauté, voilà ce que je voulais dire, merci.
00:57:19 Thomas Parisot
Ben merci à vous.
Et Jean-Philippe arrive dans l’ordre après.
00:57:25 Jean-Philippe Denis
Alors j’ai juste un petit complément. Outre que je partage totalement tout ce qui a été dit sur Cairn et le fait d’être juge et partie, juste une petite remarque en passant.
Mais la liste Fifty-Fifty, sauf erreur de ma part est faite par le Financial Times.
Je crois pas que le Financial Times soit un acteur public, donc il y a toujours, y a toujours des enjeux. Après là, le sujet, c’est l’éthique. Et c’est justement comment on garantit cette éthique.
Mais j’ai l’impression que précisément CAIRN sur ce point, en se fondant sur les consultations… J’imagine que c’est un travail qui est mené, mais…
00:57:58 Thomas Parisot
Quitte à le faire avec, pardon Jean-Philippe, avec le…
00:58:02 Aurélien Rouquet
Clarivate c’est pareil, ils sont juges et parties.
00:58:03 Thomas Parisot
Ils sont juges et parties
00:58:03 Jean-Philippe Denis
Tout le monde est juge et partie, donc.
00:58:05 Thomas Parisot
Mais on peut faire mieux, c’est-à-dire qu’il y a aussi un troisième acteur dans la boucle.
Je peux pas trop… mais le travail qu’on a fait cet été avec Le Monde, ils ont mouillé le maillot. Je dis ça aussi parce que y a aussi une éthique journalistique et aussi extérieur au monde de la recherche.
Alors les gens vont dire, c’est pas de la science , mais effectivement, ils sont assez preneurs de visualisations… de eux-mêmes avoir un certain tableau de bord de la recherche francophone, c’était juste une précision qu’il y a peut-être aussi cet acteur.
00:58:25 Jean-Philippe Denis
Et alors ? C’est ce que j’allais dire, c’est-à-dire, c’est le deuxième point. Puisqu’on évoquait des pistes d’action. Moi, je note que les lignes bougent à partir du moment où le débat sort de la communauté, sort des communautés scientifiques et juste une petite anecdote que je voudrais que je voudrais apporter. En discutant avec des dirigeants de… d’une très grande entreprise du CAC 40, il s’interrogeait sur un certain nombre de questions et quand je leur portais depuis 20 ans, ça travaillait sur ces questions-là en recherche, ils ont découvert qu’existaient des revues scientifiques.
Et autant dire que l’existence même d’un classement de ces revues – ce qui pour nous est, on est en train de discuter de tel truc, tel truc. Pour eux ils l’ignoraient complètement, mais totalement.
C’est à dire qu’il y a un travail de pédagogie vis-à-vis de l’extérieur de la communauté académique a… à faire… qui reste à faire et qui n’a jamais été fait.
Et je pense que cet article du Monde du mois d’août participe de ça, c’est à dire tout ce que CAIRN peut communiquer à l’extérieur, justement sur l’ampleur de ces consultations, sur l’ampleur de cet intérêt qu’il y a… et de cette existence, bah ne peut nous être que bénéfique parce que ça joue au service de la transparence.
Et donc de la crédibilité et t donc renforce aussi collectivement notre poids.
Alors, qu’aujourd’hui, ce poids est inexistant en dehors de la communauté des communautés académiques.
00:59:46 Thomas Parisot
Tu fais bien de le rappeler hein ?
Parce que Le Monde qui a bien l’habitude de voir des statistiques, quand ils ont vu les 281.000.000 de lectures, ce matière de 280.000.000 de lectures qualifiées dans ces établissements universitaires, quand ils ont vu ça, ils se sont dits : « C’est, c’est étonnant ! »
Le premier sujet de l’article, c’est déjà le phénomène d’usage et la matière qui est extrêmement importante alors qu’on a l’habitude de parler des réseaux sociaux, de plein de choses. Mais c’est déjà cette première représentation qu’on peut questionner donc. Mais je passe la parole à Yves qui est arrivé ensuite.
01:00:13 Yves Soulabail
Jean-Philippe, je pense que. On a oublié l’importance de notre rôle social et le fait que Jérôme Caby, pendant la réunion, ait bien stipulé que l’impact au niveau des entreprises ne soit volontairement pas pris en compte – pour moi – est un élément qui est en réalité qui est majeur !
Alors, moi j’ai rien contre Scopus, j’ai rien contre toutes les bases quel qu’elles soient. Elles ont une particularité. C’est qu’évidemment elles cherchent toutes à mettre en avant leur propre existence. C’est normal. Chaque acteur, à un moment donné, se pose la question de savoir comment son modèle économique est en mesure de pouvoir se développer !
Ce qui moi me gène c’est que l’on se retrouve avec un Jérôme Caby qui devient RP de certaines.
Et ça, c’est normalement pas son rôle. D’autant plus que, en faisant ça, il fait allégeance à certaines bases, à certaines manières de raisonner et moi de ce point de vue-là… enfin… c’est juste hors de question.
Elles n’ont pas plus de légitimité en fait… Elles sont peut être très importantes, on peut les juger… mais comme toutes les bases elles sont imparfaites, donc.
Pour quelle raison celles-ci plus que d’autres, ça devrait être beaucoup plus ouvert et on nous a clairement dit que : « Il y avait ça. Et puis il y a le reste, c’était… Ça portait finalement peu d’intérêt. »
Quoi donc en fait il est en train finalement de d’accepter l’effondrement… par ce que moi j’avais présenté comme étant en fait l’effondrement, l’effondrement du champ et… et j’avais rappelé à ce moment-là que j’avais dit qu’il allait devenir le patron d’un timbre-poste ! Moi, ce qui me gêne, c’est qu’on a chercheurs qui sont derrière pour lesquels ont est en train de travailler.
Et notre métier c’est… c’est de sélectionner. C’est de les aider à développer, à diffuser leurs idées, mais c’est aussi de faire en sorte que l’on sorte de notre champ.
Y a combien de revues en France qu’ils soient publiées… enfin, qui sont mises à disposition dans les kiosques ? Au-delà même des bases !
On a une vraie problématique là-dessus. Et c’est pas en nous tirant dans les pattes qu’on va réussir à refaire en sorte que ces publications-là puissent avoir un rôle social qui soit… enfin qui s’affirme quoi !
On n’est pas tous Américains. Y a plein de manières de raisonner.
Y a partout, dans tous les pays, y a des cultures différentes. On est là pour les… on est là pour les faire fructifier.
On n’est pas là pour, on n’est pas là pour filer les clés quoi ?
01:02:44 Thomas Parisot
David, vous voulez aussi intervenir sur ces questions ?
01:02:47 David Huron
Merci. Je souscris sur tout ce qui a été dit en profite pour vous remercier pour cette initiative. Effectivement, moi je suis au collège donc scientifique de la Fnege et je suis en position extrêmement embarrassante.
Pour une… pour plusieurs raisons. D’abord parce que, en fait, j’ai revérifié, hein.
On n’a jamais eu de compte-rendu explicite sur le fait que Scopus était obligatoire pour être rang [3] dans le cadre donc de… de comment dire… du nouveau classement.
On en a parlé, c’est vrai… Et je pense qu’on a, on a une responsabilité collective à ne pas avoir véritablement réagi par rapport à ça.
Pour la raison principale que – ce qui nous a été présenté au départ, c’est que le fait d’avoir, et qui était partagé d’ailleurs, le fait d’être dans les dans les classements Scopus et Clarivat, bah c’était en plus et donc… que ce serait – comment dire – valorisé de cette manière-là. Ce qui en revanche n’a jamais été, comment dire, dit en tant que tel, si ce n’est depuis le mois de juillet à peu près, hein ?
C’est que ce serait obligatoire.
Et nous, je peux vous dire que nous, on y a beaucoup travaillé – alors moi je représente un peu le management public dans, dans le corpus du collège. On y a beaucoup travaillé et aujourd’hui on se retrouve à avoir monté des dossiers. On attend le bien vouloir de ; à la fois Scopus et Clarivat et on va se retrouver gros Jean comme devant, si en fait on est… On dit que : « Ben, il faut absolument être référencés dans les classements. »
Ce qui ce qui m’interpelle. C’est la réflexion tout à fait pertinente de Véronique sur la citation des références Scopus pour être référencé dans Scopus.
Alors là, on est vraiment dans la… On a atteint un degré paradoxal !
Alors moi je voudrais quand même interpeller toutes les personnes qui sont qui sont ici. Un seul président de d’association ne peut pas peser dans l’ensemble des collèges, donc il faut véritablement que vous mobilisiez vos représentants demain parce que je vous rappelle que la réunion de
demain c’est d’entériner une commission qui aura été décidée par la Fnege et le processus est enclenché.
Donc, à mon sens, il faudrait que il y a une notion de la part des présidents et notamment des présidents des – entre guillemets – « grosses associations » qui disent : « Bah Okay, Okay pour prendre en compte un Scopus ou un Clarivat mais ne pas en faire une condition rédhibitoire pour que ce soit… en fait… dans… on va dire un classement en deuxième ou même rang 3…
01:05:37 Thomas Parisot
Tout à fait.
Et vous avez raison de rappeler David que le temps de moyens pour intégrer un Scopus ou Web od Science, c’est un, un an et demi, 2 ans, il y a des revues qui n’y sont pas parce qu’elles n’ont pas candidaté et qui le font.
Et avec un temps d’attente qui est incroyablement long, hein donc, et qui s’allonge le temps passant. Donc, c’est aussi se mettre dans un processus, ne serait-ce que pour des questions d’organisation nécrologique, où on risque de discriminer des revues sur des mauvais critères qui ne sont même pas la logique scientifique. Effectivement.
01:06:01 David Huron
J’ajouterais que c’est castrateur parce que, en fait, on joue le jeu et en fait on est – comment dire – sanctionné sur la base de choses que l’on ne maîtrise pas, nous on a redemandé au mois de septembre où est-ce qu’on était dans l’évaluation de notre dossier. On nous a dit : « Bah, ça prendra entre 6 et 10 mois au mois de septembre Hein », donc c’est mort.
01:06:25 Thomas Parisot
Tout à fait.
Daniel, vous voulez intervenir aussi ?
01:06:29 Daniel Bretonès
Oui, donc je voulais effectivement revenir sur cette affaire Scopus parce que j’étais peut-être pas dans les bonnes réunions.
Il y a 3 ans, mais il paraît qu’il y a 3 ans, ça a été explicité clairement qu’il fallait que les revues francophones se préparent à s’intégrer et avaient trois ans pour s’intégrer à l’environnement Scopus. Donc certains ont plus d’ancienneté et savent ce qu’il faut en penser.
On l’a découvert un peu tardivement, mais bon, de toute manière, effectivement, il y a un normage sur les règles d’éthique, sur des présentations.
On peut faire évoluer VSE sans problème, la revue VSE sur ces normages. Et je crois que derrière ça en fait, maintenant, il y a des gens qui parlent… Parce que CAIRN a un rôle fondamental c’est la première plateforme francophone solide d’articles scientifiques, mais pas que scientifiques et vous avez plein d’autres revues. Un rôle fondamental, en fait, pour faire la promotion, en fait, de ce qui est produit non seulement en France, mais dans l’espace francophone.
Alors, y’a un certain nombre de professeurs d’écoles de commerce, autour de la table, et j’ai moi-même été professeur d’école de commerce. Ce que je voulais dire, c’est que… on a des jeunes gens qui nous envoient des articles maintenant, qui ont été formés dans un monde dans des écoles, où on ne parle plus français, carrément.
Y a une majorité de profs internationaux. Ils savent même plus, en fait, s’il y a une recherche française, donc le travail il est à faire dans nos écoles, à faire redécouvrir la recherche francophone dans les écoles qui sont de plus en plus anglicisées, américanisées.
Et à tel point que je reçois des articles où il n’y a plus de références francophones et il m’est arrivé récemment sur un sujet qui était, qui me passionnait et qui me touchait personnellement d’aller voir s’il y avait des références francophones intéressantes.
Bon, j’ai tapé sur CAIRN. J’ai trouvé plein d’articles en français.
Donc, des jeunes Français qui sont… passent par un système, en fait, qui sont… y a plus de cours en anglais dans toutes, en français dans toutes les écoles de commerce.
Ils ne vont pas voir la recherche francophone. C’est-à-dire qu’on perd pied par rapport à notre terrain. socio culturel, historique, voilà. En contrepartie, on a de plus en plus d’un lectorat africain, mais pas que… qui lit en français. Donc, il y a une énorme demande. Donc, moi je suis effectivement à la recherche d’un modèle plus francophone. Est-ce qu’il va falloir passer par développer un espèce de de référentiel francophone dans les universités pour les publications les américains ont posé leur modèle parce qu’on peut parler en terme de modèle avec l’ACSB. Et on a fortement fait rentrer dans un moule qui était pas un moule culturel français, mais qui a des caractéristiques intéressantes.
Plus tard, c’était EQUIS. C’était un autre format piloté par des Européen mais quand même – derrière – très anglo-saxons. Est-ce qu’il faut pas que les universités, les écoles françaises, se remettent autour de la table pour dire qu’est-ce que c’est qu’un référentiel francophone qui puisse être utilisé dans le monde entier par les francophones du monde entier ?
Et alors, je pense qu’effectivement CAIRN est bien placé pour nous fournir des tas d’outils d’évaluation, des citations, des référencements et ainsi de suite.
Voilà, donc moi je suis favorable à ce qui est une stratégie quand on voit ce qui se passe au niveau mondial, sur l’Amérique du Nord, sur la Chine, sur d’autres grands ensembles. Si on n’a pas de stratégie, va partir en lambeaux et on va se faire… On va se déliter progressivement.
Je pense qu’il faut en stratégie. Il faut des objectifs, des actions, un minimum de moyens. Y a des outils comme CAIRN qui sont extrêmement performants. On doit pouvoir rebâtir le monde francophone du futur qui est en train de partir en lambeaux à mon avis.
On fait ce qu’on peut avec nos revues. Je suis pas le seul, y en a plein autour de la table. Autour de l’écran, devrais-je dire.
Voilà, un petit peu ce que je pense que nous allons faire et si effectivement on peut pas
continuer parce qu’on n’a pas l’agrément Scopus tout de suite, on peut pas être prêt dans les délais… On continuera quand même à se battre et à produire, en francophone, ou à traduire quelques articles francophones quelquefois en anglais ce qui est autorisé par là Fnege pour le moment. On pourra en discuter avec des quotas minimum.
Pour être lu, mais dans un cadre conceptuel qui est francophone.
01:10:51 Thomas Parisot
Absolument et encore une fois y a beaucoup d’ambivalence y a du très bon et du très impressionnant en ce moment.
Alors y a plus de revues en kiosque, mais il y a des millions de lectures. Encore une fois, 80% du trafic de CAIRN vous savez n’est pas institutionnel. Donc, on s’est concentré avec Le Monde sur le trafic institutionnel, mais y a énormément de trafic, alors on peut-on peut en dire beaucoup hein ?
C’est là où l’analyse quand on l’écoutait tout à l’heure, c’est pas un classement, c’est de la recherche qu’il faut faire là-dessus, sur ces grands corpus de données avec des angles différents, des logiques différentes, différentes hypothèses. D’où, effectivement aussi, ce que pointe Benjamin disant : « C’est pas qu’une question d’outils, prêt à l’emploi et sur l’étagère », c’est vraiment une question d’appropriation par la communauté de la recherche des données et de ce qu’elles veulent dire finalement et dans le cadre d’une stratégie d’objectif.
Mais Yves aussi, je vous redonne la parole, vous avez levé la main.
01:11:35 Yves Soulabail
Quand je fais cette remarque sur les kiosques, c’est que j’adore ce que fait CAIRN.
Sauf que CAIRN n’est pas en accès libre sur la totalité de sa base et elle n’est pas accessible pour… enfin… Il faut généralement faire la démarche d’aller chercher et pas trouver par hasard et notre rôle sociale, c’est aussi de pouvoir être trouvé par hasard, par des gens qui – au détour d’un voyage – aient possibilité en fait d’avoir des éléments de réflexion qui vont changer leur vie et leur entreprise.
Moi, ce qui me paraît le plus étrange, en fait, c’est que… ce que je constate.
Ce qu’il y a bien, en fait, il me semble-t-il une banque est en train de se faire ?
Ceux qui sont en train de se dire la francophilie, la francophonie n’est pas morte et ceux qui considèrent en fait qu’elle est déjà derrière nous.
Et je pense que la Fnege pour l’instant, au travers de Jérôme Caby… Moi je ne sais pas tout ce qui se passe dans les bureaux, je n’y suis pas est est en train de nous dire, finalement, vous êtes déjà dans le monde… dans le monde d’hier. Et moi j’ai… moi, j’ai envie de lui dire… enfin de dire… pas à lui en particulier, mais de dire mais je pense que c’est faux.
Je pense que c’est l’inverse qui est en train de se faire et que partout dans le monde les populations en fait sont recherche de solutions, mais des solutions qui soient les leurs, pas des solutions qui soient venues d’ailleurs. Et il y a, je pense que en fait, on est en train de faire un rebours… Enfin, on est en train de faire trop tard, des choix de nous emmener vers un monde américain qui lui-même se remet en cause.
On a encore un train de retard, quoi.
Et ça, moi je pense que c’est… Il est temps, pas simplement de dire mais il est temps d’agir parce que l’important c’est pas, c’est pas simplement de… on peut autour autour de cette table virtuelle. On peut tous être d’accord, mais la question c’est : « et quid de demain ? »
01:13:35 Thomas Parisot
Tout à fait.
01:13:36 Yves Soulabail
Parce que parce que demain c’est déjà tard la Fnege, est en train… Enfin, Jérôme Caby dans son dans son raisonnement est en train de nous, potentiellement, … et il le dit, il accepte en plus que 2/3 des publications soient volontairement déclassées.
Moi je serais atterré si je j’avais à prononcer cette phrase-là. Enfin, et ça ne le choque pas lorsqu’il le dit.
Euh ! C’est quand même étonnant que quelqu’un qui est censé défendre la gestion des entreprises françaises acceptent quelque chose comme ça. Enfin, est-ce que c’est, c’est… Il veut faire partie d’une classe internationale, mais ils sont complètement détachés de la réalité de terrain quoi.
Enfin, y a un moment donné…
Moi je vois pas d’inconvénient à ce qui à ce qu’il certains souhaitent aller dans ce sens-là je leur refuse la possibilité de nous juger, ce qui est différent.
Qu’il considèrent qu’il n’y a que Scopus qui existe… Bon ! Il veut être RP, il peut l’être.
Moi j’ai pas d’inconvénient à ce qu’il soit VRP. Mais dans ces cas-là, qui ne soit pas juge par la même occasion de la qualité.
En réalité, la Fnege pour l’instant nous aide – finalement – quand même assez peu au niveau des publications. Ils sont en train de nous juger, mais qui sont-ils ?
D’autant plus, quand on lit les documents qu’ils produisent, y a quand même bien le fait qu’il soit à la fois… Ils veulent tout faire.
Il va être juges, procureurs, avocats… Ils veulent tout faire. C’est pas possible.
01:15:20 Thomas Parisot
Je vois que dans le chat, et effectivement de se dire, qu’il y a le débat de fond et de pas trop être sur le bouc émissaire Fnege. Mais effectivement, il y a des questions.
C’est vrai qu’ils ont une position assez dure qui de fait appelle aussi, et j’entendais bien moi cette mobilisation aussi pour la réunion de demain qui est l’horizon très très court terme, et cet appel à l’action, hein, Yves qui à mon avis est la meilleure façon de prendre un peu la main par rapport à des constats et encore une fois parce que on en a un peu des outils.
Je me permets de le dire parce qu’effectivement, on arrive à un moment où il y a 5 ans, il y a 10 ans, on aurait laissé passer les trains et là on a quelques outils pour – Si effectivement on veut construire une logique alternative, qu’on puisse le faire, pas à un horizon complètement éloigné, en tout cas, pas tellement plus éloigné qu’une labellisation Scopus finalement.
01:16:00 Yves Soulabail
Mais sauf qu’il est en train… C’est là où moi, je comprends pas cette manière de raisonner. C’est que volontairement il est en train de vouloir le balayer.
C’est-à-dire qu’il dénie la réalité.
Alors, soit il n’est pas informé, ce qui est possible, soit c’est une volonté et dans ce cas là, c’est politique. Mais alors il va falloir nous expliquer qui est en train de tirer les ficelles là-dessus, hein ?
Et quels sont les intérêts qu’il sont en train de servir ?
Parce que nous, les seuls intérêts qu’on reconnaisse, c’est ceux de nos chercheurs et la défense des idées.
Et ça, ils sont en train de… Ils sont en train d’aller à l’encontre, en fait de la communauté. C’est… Quelle est l’utilité ?
Enfin… A qui ? Qui on en train de servir ?
01:16:42 Thomas Parisot
Je vois qu’on arrive un peu à la fin du temps imparti.
Michel, vous vouliez peut-être une réaction et puis après… ?
01:16:48 Michel Berry
Non, non… C’est juste pour dire que – à l’origine – la Fnege a été créée pour envoyer des jeunes brillants français aux États-Unis se former, se former au management en « management science ».
Donc, c’était une institution qui importait massivement des idées d’Amérique.
J’ai l’impression qu’elle revient sur ce… sur cette base originelle.
C’est quoi la Fnege ? Finalement, leur budget est faible et c’est plus grand chose d’autres qu’un pouvoir, une sorte de pouvoir de nuisance via les classements. Ils s’érigent en juge de la production française en matière de gestion. De quel droit ? C’est quoi ? Alors… Ben, s’ils prennent cette position et tout le monde l’accepte. Ils auront gagné leur coup mais pourquoi accepter que la Fnege soit l’instance qui juge ? Elle a plus beaucoup de moyens avant il me semble la plus beaucoup de budget que beaucoup de moyens. Avant, elle aidait. Elle soutenait les projets. Elle a que ce moyen de classification… C’est quand même incroyable !
01:17:54 Thomas Parisot
Et encore une fois, revenir à de la donnée plutôt qu’à de l’opinion ou du jugement, hein, effectivement.
01:17:56 Michel Berry
Oui, puis je dis toujours que je disais tout à l’heure, la colonisation commence dans la tête du colonisé et je pense que… On y est avec la Fnege.
01:18:05 Yves Soulabail
Et on n’a pas envie.
01:18:06 Thomas Parisot
Je… Laurent, Aurélien.
Et puis je, on va essayer, on arrive…
01:18:10 Michel Berry
En fait, c’est maladroit. En plus, c’est comme si c’est comme si les Français avaient aucun pouvoir de réflexion. Comme s’ils n’avaient pas de créativité. Il y a pas d’originalité.
Puis un électron, si un électron est le même à Paris, New York où Tokyo. Un problème de gestion ne se pose pas de la même manière… ne se résout pas forcément de la même manière à Paris, Tokyo et New York. Donc, il y a forcément des singularités. Les gommer, c’est complètement.
01:18:34 Yves Soulabail
Elle est… elle a jamais été… La France n’a jamais été meilleure, alors qu’à un moment donné, lorsqu’elle se met à résister à ce qu’un moment donné ça lui donne, ça lui donne en fait une manière d’exister parce qu’on a un esprit quand même à ce chamailler et c’est très bien, mais du jour on arrive à avoir des volontés communes et un chemin que nous nous donnons à partir de ce moment-là… Cet esprit-là est quand même. Enfin, historiquement, il a toujours été très puissant quoi.
Il faut retrouver ça.
01:19:07 Michel Berry
Mais je… quand on a….
01:19:07 Yves Soulabail
La question, c’est avec ou sans la Fnege !
01:19:09 Thomas Parisot
Michel. Michel et Yves, je crois qu’on va…
01:19:09 Michel Berry
Quand on a créé Gérer et Comprendre, je vous qu’il fallait se battre pour exister. Et ça a donné beaucoup de créativité au début.
01:19:24 Thomas Parisot
On peut entendre rapidement Laurent et Aurélien et puis on va s’arrêter là un petit peu pour aujourd’hui, sachant que, à mon avis, dans les actions, on vous renverra à la fois les éléments de cette vidéo et choses comme ça.
On vous tiendra au courant, c’est-à-dire…
On est aussi preneurs, bien sûr, pour celles et ceux qui auront des infos de la réunion de demain, de la suite des événements. Parce que ça veut dire aussi continuer à suivre attentivement ce sujet, mais je laisse la parole tout de suite à Laurent puis Aurélien.
01:19:44 Laurent Cappelletti
Oui, donc juste un… On est sur un débat qu’on retrouve en contact entre l’audit, c’est-à-dire que y a des classements – moi je dirais – en comptabilité académique. C’est ce que fait la Fnege. On peut critiquer ou pas ? Moi, je trouve que d’un de vue académique l’angle pris par la Fnege, à condition de dire… se respectent. On pourrait faire autrement, et caetera.
Voilà. En revanche, ce que ne fait pas la Fnege. Et ce qu’on devrait faire et ce qu’il faut faire.
C’est des classements ou des indicateurs en comptabilité extra académique, c’est à dire d’impacts sociétaux.
Voilà, et sur cette… donc ne pas vouloir remplacer les classements académiques, quelles que soient les institutions qu’ils le font. Mais s’inscrire, et on a toute légitimité, en complément de ces classements sur un classement d’impact sociétaux, on va dire extra académique.
Deuxièmement, sur l’histoire du : « on peut pas être juge et partie et caetera, des biais ».
C’est dès qu’on fait quelque chose. Il y a du biais, faut surtout pas chercher à la perfection à éviter les biais. C’est la base d’ailleurs des sciences de gestion en fait. Mais ce qu’il faut, c’est de la transparence sur la méthodologie.
De… utiliser pour produire les indicateurs, classer, etc. La transparence et chacun après juge, voilà ce qu’il faut c’est une transparence absolue. Une non clandestinité parce que très souvent ce qui font des règles très pures pour éviter le juge et le partisme.
En revanche, il y a une clandestinité des débats derrière. Voilà. Donc transparence, voilà.
01:21:35 Thomas Parisot
C’est noté dans l’esprit.
Et Aurélien !
01:21:39 Aurélien Rouquet
Oui, moi je voulais dire deux, trois choses.
La première chose, c’est que là on est entre nous tous convaincus de l’importance de la recherche francophone en sciences de gestion. Mais soyons très clairs, ce n’est pas un point de vue partagé au sein de la communauté.
Moi… j’ai des collègues en école de commerce et c’est vrai dans les écoles… Qui n’int même pas dans leur paysage, dans leur visée les revues françaises. Donc, voilà.
Et dans la communauté francophone, on a aussi des gens.
Moi j’ai discuté avec des rédacteurs en chef qui disent mais non, on peut pas se comparer à des revues internationales. Voilà. Donc très clairement le point de vue qu’on a nous n’est pas forcément partagé et donc ça explique aussi la position de la Fnege et ce qui explique à mon avis aussi et ce qui ce qui conduit à me faire dire que c’est absolument important de, entre guillemets d’instaurer une forme de rapport de force, en tout cas de produire quelque chose d’autre pour instaurer un rapport de force avec ses classements. Et pour moi, très clairement, le texte n’aura pas d’importance.
Michel en a parlé, il a écrit un texte qui a très longtemps. On a fait un texte dans Le Monde. Ça ne changera rien de se montrer uniquement critique sur ces classements et leurs limites.
Ce qu’il faut, c’est produire quelque chose d’autre, et je pense que je rejoins tout à fait aussi ce que disait Laurent ? C’est que l’enjeu, c’est d’avoir un critère différent que ce critère académique.
Et qui serait un critère d’impact. Voilà auprès des étudiants, auprès des entreprises, dans les médias.
Enfin voilà pour pouvoir justement montrer, bah, bien sûr qu’on sert aussi autre chose que d’être uniquement lu par des des académiques et ça je pense que c’est vraiment à mon avis la marche à suivre. Et en imaginant peut-être une forme de gouvernance de ces classements qui serait autre que ces classements actuels qui sont complètement opaques.
Que ça soit les classements des journaux ou les classements de… d’autres organismes qui pourraient assembler diverses parties prenantes : Le Monde, CAIRN, des représentants du monde académique, pourquoi pas la Fnege. Et là, ça nous donnerait, je pense aussi une… une force en termes de légitimité.
01:23:45 Thomas Parisot
Bien noté et on a d’ailleurs – il faut le savoir – dans des tiroirs, pour différentes raisons, des projets par exemple de fondation, aussi de choses qui peuvent être aussi des façons aussi d’associer différentes parties prenantes en lui donnant certains supports logistiques.
Enfin, y a des choses à réfléchir, hein ?
On continuera à abonder la… On va pas repartir avec des solutions, mais en tout cas on entend tout ce que vous dites et l’esprit dans lequel on devrait aborder ces chantiers.
David peut être une dernière intervention, puis peut-être on s’arrêtera là aujourd’hui.
01:24:10 David Huron
Juste pour signaler que, au départ, quand on a reparlé du classement en 2022 à l’époque… Donc, il était question d’en faire en 2025, et pas forcément plus. Histoire d’accompagner les revues francophones à – comment dire – s’internationaliser pour avoir une meilleure lisibilité.
Mais c’était en fait une logique d’internationalisation pour améliorer la vue, c’était pas une logique de rentrer dans des canons et être exclusif.
Donc je… voilà, on y a une déviation là que je ne comprends pas, surtout lorsque les rédacteurs en chef sont rentrés dans la logique et malheureusement ne sont pas arrivés au bout de de la logique pour des raisons qui sont extérieures.
01:25:02 Thomas Parisot
Absolument. Bon. Ben en tout cas merci beaucoup à toutes et tous pour ce matin. Je pense qu’il y avait quelques propositions de faire circuler notre webinaire hein, on va pas le mettre en ligne sur CAIRN en page d’accueil, mais en tout cas le faire circuler et lui donner un caractère un peu plus circulant pour publiciser le débat. Encore fois on sera preneur du retour de la réunion demain qui est quand même un des jalons important pour voir comment s’amende, se structure ou pas… Et encore une fois, David le rappelait d’ailleurs, le poids des associations au-delà des revues de savoir parce que c’est une gouvernance partagée et là ça nous dépasse.
Mais bien, que le débat collectif est bien lieu. Que ça ne se passe pas sur des malentendus, en tout cas si je puis dire. Et puis on poursuivra, c’est-à-dire que la logique de que ce soit avec les parties
prenantes qu’on a évoquées, puis de structuration d’une initiative avec une gouvernance qui soit saine, dans un esprit de transparence et avec des outils qui permettent de faire des logiques d’analyse diversifiées et pas seulement une hiérarchisation selon une lecture de ce que doit être la recherche.
Effectivement, ça fait autant de pistes un peu stimulantes sur lequel vous aurez compris que nous, en tout cas CAIRN, on pense que notre mission c’est de jouer un rôle là-dedans.
On pourrait s’en laver les mains, mais je pense que c’est important pour tout le monde qu’on puisse être un peu collectivement dans une logique constructive et encore une fois non pas mercantile et non pas de conflit d’intérêts.
Voilà bah donc on… à bientôt sur ces sujets finalement et puis au plaisir de continuer à discuter avec chacune et chacun d’entre vous.
Merci. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.
Les bases de classement évoquées