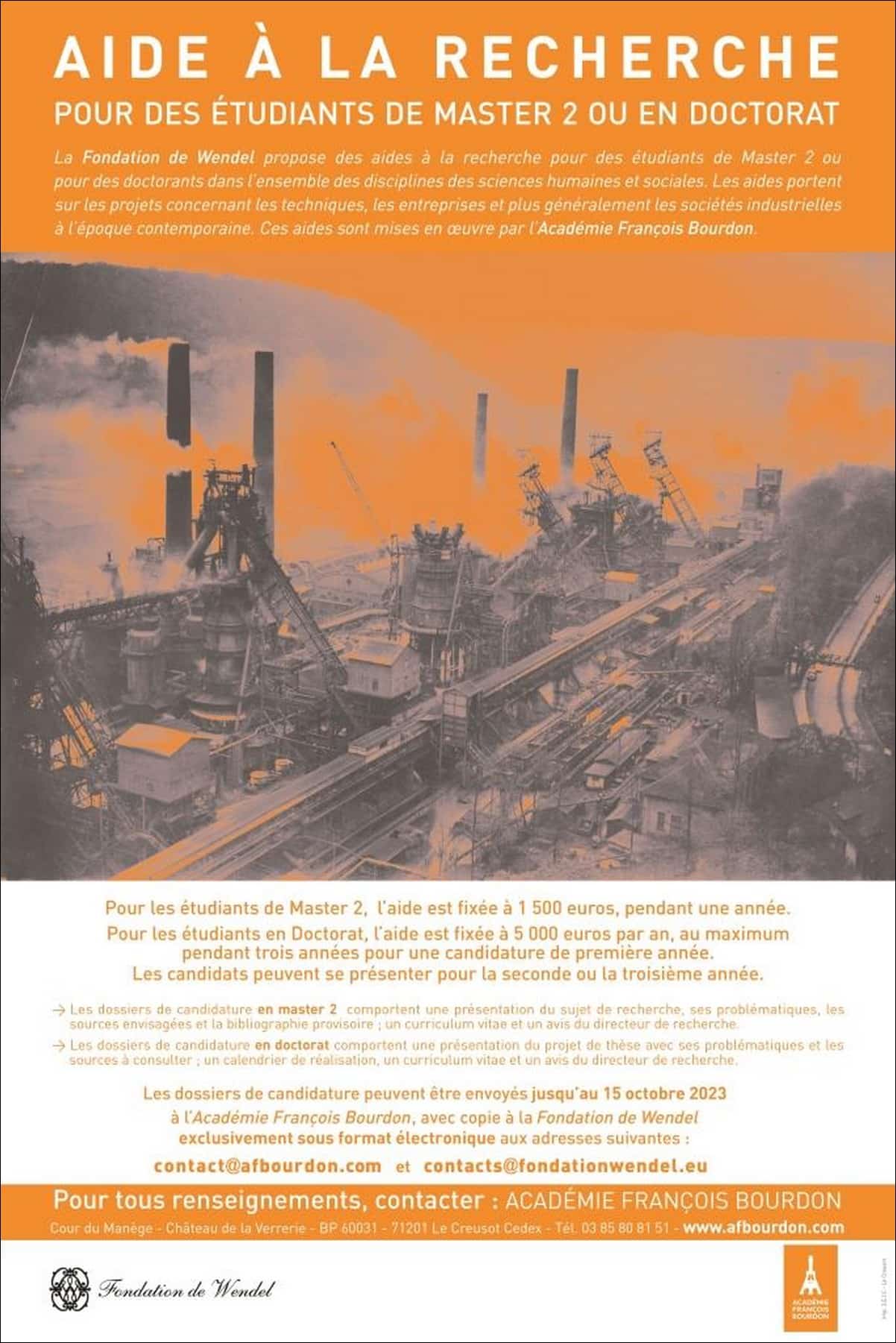Appel à communication du colloque : “Pouvoir d’agir des usagers en France et au Québec : partage de connaissances pour une plus grande démocratie en santé”
Le colloque aura lieu en ligne sur ZOOM
le jeudi 13 juin de 14h00 à 18h30
- 14h00-16h00 : plénière
- 16h00-18h30 : ateliers
La Revue des Sciences de Gestion, la chaire de Gestion des services de santé du Conservatoire National des Arts et Métiers et le laboratoire LIRSA (EA4603) proposent une nouvelle édition du colloque « Démocratie en Santé ».
Cette deuxième rencontre – qui fait suite à une première édition “Démocratie en santé et pouvoir d’agir en santé” en juin 2023 – réunira cette fois des spécialistes des pratiques québécoises et françaises, afin de mieux comprendre les apports et les limites des initiatives développées des deux côtés de l’Atlantique, mais également afin de partager les résultats d’expérimentations et de programmes de recherche impliquant des patients-partenaires.
L’objectif reste de promouvoir une discussion interdisciplinaire et d’alimenter de nouvelles pistes de réflexion pour tous les acteurs de la démocratie en santé : usagers, professionnels, représentants des tutelles, chercheurs, etc.
Cet appel à communications appelle des travaux, notamment sur :
- le statut des patients-partenaires : du bénévolat au salariat ? Quels choix ? Pour quelles conséquences ?
- accorder une place croissante aux proches dans le système de santé et les parcours de soins : quelles limites données par la règlementation ? Quels atouts pour les soins et l’accompagnement des personnes ?
- les patients-partenaires au sein des équipes de soignants : quels impacts sur l’organisation du travail, les rôle et les missions des professionnels ?
- pouvoir d’agir des usagers : quel apprentissage organisationnel au sein des établissements ? Quelle gestion des connaissances au sein des équipes ?
- démocratie en santé et pouvoir d’agir des usagers : où en est vraiment la transformation épistémique ?
- pouvoir d’agir des professionnels : une attente forte de la part des équipes ? Une nécessité pour garantir le pouvoir d’agir des usagers ?
- le pouvoir d’agir et la e-santé : le pouvoir d’agir est-il un levier d’expérimentation, d’adoption et de déploiement des outils de la e-santé ?
Cette liste n’est pas exhaustive, les propositions qui apporteraient une contribution qui ne s’inscrirait pas dans l’un des axes proposés seront examinées avec la plus grande attention.
Deux types d’article peuvent être proposés
- Articles académiques. Ils pourront se fonder sur des études empiriques tout autant que déboucher sur des approches pluridisciplinaires. Leur pertinence sera appréciée au regard de l’apport académique et de l’apport managérial.
- Témoignages. Cette dimension ouverte se fondera sur une expérience individuelle ou collective mais ne se contentera pas d’une forme narrative, elle devra inclure une problématisation débouchant sur des pistes éventuelles de solution ou de recherche.
Modalités de soumission
MODALITÉS DE SOUMISSION des communications au colloque et sélection des articles pour un numéro spécial de la revue des sciences de gestion
- Remise des résumés pour le colloque : 15 avril 2024
- Retours aux auteurs : 2 mai 2024
- Date limite des inscriptions au colloque : 15 mai 2024
- Remise de la version intégrale de l’article (50.000 signes espaces compris, bibliographie, schémas, figures, tableaux compris) :
- Publication du numéro spécial de La Revue des Sciences de Gestion : juin 2025
- Possibilité d’un ouvrage collectif en complément
Adresse de contact : colloque@larsg.fr
Comité d’organisation
- Sandra BERTENEZE, Professeur, titulaire de la Chaire de Gestion des Services de Santé · Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
- Jean-Désiré MBAYE, secrétaire général adjoint de la Rédaction de La Revue des Sciences de Gestion
- Philippe NASZÁLYI, Professeur émérite HDR, Directeur de La Revue des Sciences de Gestion.
- Yves SOULABAIL, Professeur-Chercheur en gestion à l’ISTEC Business School – Paris, Vice-président de l’Académie des sciences commerciales