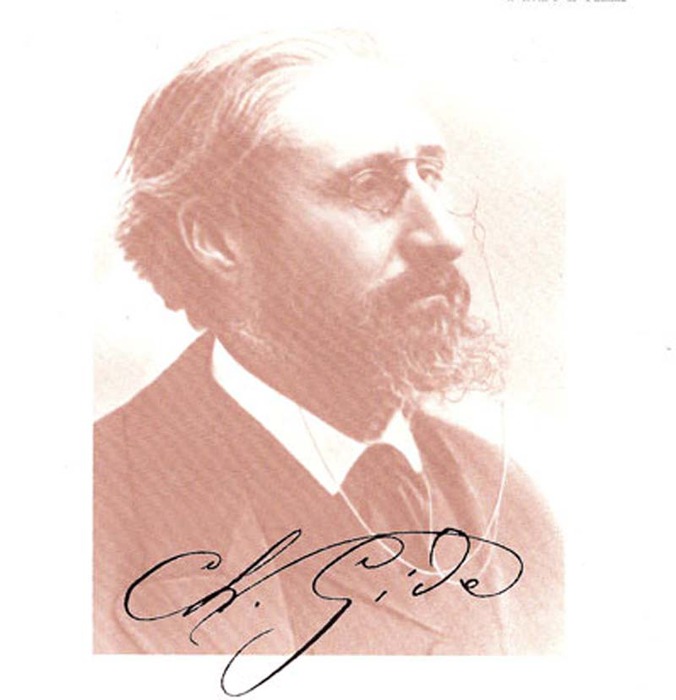Innovations sociales, innovations
économiques
Organisées par le Centre de recherche en économie
de Grenoble (EA 4625)
Jeudi 11 et vendredi 12 septembre 2014
Appel à communications
Depuis le début des années 2000, les pays de l’OCDE et beaucoup de pays émergents adoptent des
stratégies d’amélioration de leur compétitivité comportant un volet d’innovation technologique et économique. En Europe, de façon très explicite, l’énoncé de la stratégie de Lisbonne en 2000 puis
2001 vise à conduire l’union européenne vers une « économie de la connaissance » performante à haut degré de cohésion sociale. Il s’agit d’investir dans la R&D, de faciliter le passage de la
recherche à l’innovation, d’améliorer le capital humain et la formation tout au long de la vie tout en développant une action contre l’exclusion sociale. Malgré les difficultés d’application des
années 2000, cette conception est reprise et reformulée en 2010 dans les objectifs d’Europe 2020, visant une croissance « intelligente, durable et inclusive ». La question de l’innovation est
devenue centrale dans l’économie. Elle est alors conjuguée dans les stratégies économiques et sociales nationales avec des modèles sociaux visant plus de flexibilité accompagnant l’innovation et
avec une recherche de sécurité pour les populations fragilisées par les changements. Les modèles de flexicurité sont déclinés de manière différenciée dans les pays européens.
L’entrée en crise des pays de l’OCDE et plus particulièrement de l’Europe suscite de nombreuses
questions relatives aux modèles de société de la connaissance basée sur l’innovation. Ces questions impliquent également les pays émergents. Outre les aspects financiers de la crise souvent mis
en avant, des questionnements se développent au sujet des stratégies de flexicurité. Les orientations vers des efforts de recherche, de formation initiale et continue sont assez souvent admises.
D’autres éléments prêtent plus à discussion, que ce soit la remise en cause des protections sociales dans un contexte idéologique et financier défavorable à l’interventionnisme étatique,
l’abaissement des coûts du travail accompagnant les stratégies de compétitivité, le développement de la précarité entrainé par la recherche de flexibilité, l’accent mis sur la logique du workfare
dans la lutte contre l’exclusion sociale, etc. Autant d’orientations qui suscitent des interrogations sur le modèle social susceptible d’accompagner une économie de l’innovation.
Dans la grande mutation qui démarre en 2008, les Etats sont conduits parfois de façon radicale
à réviser leurs politiques sociales, non pour s’adapter à une nouvelle série de besoins mais pour faire face aux contraintes budgétaires. Avec des moyens limités ou diminués, les politiques
sociales amorcent un repli suscitant des débats sur la conduite des politiques budgétaires et monétaires. La contrainte financière n’empêche pas la croissance des besoins, l’apparition de
nouveaux besoins, ni l’émergence de pratiques sociales nouvelles annonçant une mutation des modèles sociaux.
La nouvelle donne démographique et le vieillissement des populations suscitent de nouveaux
besoins sociaux dans le domaine de la santé et de la dépendance. Paradoxalement, les innovations sociales traduisant de nouvelles aspirations et permettant l’évolution des pratiques se
développent dans tous les champs sociaux. Les innovations sont particulièrement significatives dans le champ de l’économie sociale et solidaire (ESS). Les associations créent de nouveaux modèles
de réponses aux besoins sociaux, les coopératives adoptent une forme alternative de la relation d’emploi, les entreprises sociales souhaitent mettre en cohérence leurs activités avec des valeurs
collectives. En France, les partenaires sociaux reformulent la question de la flexicurité en investissant les problématiques de sécurisation des parcours professionnels, de sécurité sociale
professionnelle, d’encadrement des transitions pour aborder dans leur ensemble les changements des pratiques sociales et une nouvelle articulation des temps sociaux. Par accumulation de petits
changements, les innovations sociales se développent.
Le colloque investira donc ce champ d’interrogations autour de l’innovation et de sa dualité, à
la fois au cœur de la recherche de compétitivité économique (avec ses implications sociales d’investissement dans le capital humain et de maîtrise de la cohésion sociale) et en même temps au cœur
des nouvelles aspirations sociales (nouvelles formes de solidarité et de fonctionnements sociaux produisant leur propre logique économique, leurs implications managériales et financières et
parfois leurs propres systèmes de financement).
Pouvant donner lieu à des analyses globales, sectorielles ou monographiques, ces entrées par
les innovations sociales et économiques peuvent se décliner en plusieurs axes de travail.
Problèmes et questionnements
Les innovations économiques et sociales suscitent au moins cinq thèmes d’approfondissement liés
les uns aux autres.
1) Nouvelles pratiques sociales, développement socioéconomique, soutenabilité.
L’innovation technologique et économique génère des changements sociaux et entraine ses propres
exigences sociales : investissements dans la formation initiale et formation tout au long de la vie, lutte contre le décrochage scolaire. L’innovation sociale a sa propre dynamique et repose sur
ses propres logiques : réponses aux nouveaux besoins sociaux, aux nouvelles réalités démographiques, aux évolutions des structures familiales, aux besoins de parité entre hommes et femmes, aux
aspirations à une économie plus « soutenable », etc.
Les pays riches et les pays pauvres se reposent la question
des modalités de leur développement social. L’innovation accompagne un travail sur les conditions sociales d’un développement respectant les besoins des générations futures. La recherche nouvelle
d’un équilibre entre les « trois piliers » du développement durable, l’économie, l’environnement, le social inspire des changements significatifs des pratiques sociales.
Les innovations concernant les pratiques financières sont également très nombreuses pour faire face aux problématiques de la pauvreté ou
du développement. Autour du thème finance et innovation sociale de nombreuses recherches apparaissent sur les monnaies sociales complémentaires, les pratiques de micro finance et la construction
d’une finance inclusive. Les partenaires sociaux cherchent également à créer des capacités de financement propres à alimenter les besoins des entreprises du secteur social au sens
large.
Cet axe est donc ouvert aux communications portant sur l’observation et l’analyse des nouvelles pratiques
sociales accompagnant ou concrétisant l’innovation.
2) Nouveaux modèles économiques et sociaux, flexicurité, sécurisation des parcours
professionnels.
La société de la connaissance en Europe appelle un nouveau compromis social favorable à
l’innovation économique. La libéralisation des échanges commerciaux, l’externalisation et les progrès technologiques s’accompagnent en effet de nouveaux risques sur les marchés du travail et de
besoins accrus de sécurité des personnes confrontées à la mobilité. Une plus grande flexibilité interne ou externe, une protection sociale plus adaptée à la mobilité : l’ensemble du champ social
est questionné.
Les nouvelles formes d’emploi distendent souvent le lien avec la protection sociale. La qualité de
l’emploi est souvent mise à mal dans les évolutions de l’industrie et des services et on assiste à une déstabilisation de la relation salariale. A cet égard, les questions de santé et de
bien-être au travail ainsi que l’accès à la couverture maladie complémentaire apparaissent comme des enjeux importants de ces transformations. L’enjeu de la sécurisation est particulièrement
important pour les jeunes qui sont triplement pénalisés par l’ampleur du chômage, par la précarisation croissante de l’emploi et par des perspectives de carrière qui impacte négativement leurs
droits à la retraite.
La thématique de la sécurisation des parcours professionnels propose d’intégrer une approche
tout au long de la vie allant de la formation initiale à l’accompagnement de la vie active (santé, politiques familiales, revenu minimum, travail) et à la transition vers l’inactivité (systèmes
de retraite, question de la dépendance). Ces dispositifs qui concernent la protection sociale et l’indemnisation des transitions sur le marché du travail, les politiques d’emploi et de formation
professionnelle, la réglementation du marché du travail se déploient dans des contextes nationaux divers. Selon ces contextes, de type libéral ou social-démocrate, ils accordent une place plus ou
moins grande aux individus et au marché, à l’Etat social et aux régulations collectives.
Cet axe est donc ouvert
aux communications analysant les pratiques de flexicurité, l’évolution des rationalités et des modèles économiques et sociaux. Il sollicite les approches institutionnelles, comparaisons
internationales, analyses de modèles nationaux, de même que des apports de connaissances sur les nouvelles formes d’emploi et les transitions socio-professionnelles tout au long de la vie
(formation initiale, vie active, inactivité, retraite…).
Des analyses ciblées sur la mise en oeuvre et l’impact de
dispositifs de sécurisation sont également souhaitées, incluant formation initiale, accompagnement en cours de vie active (santé, politiques familiales, revenu minimum, travail) et vers
l’inactivité (systèmes de retraite, question de la dépendance). Une attention particulière sera portée sur le rôle de l’orientation et de la formation professionnelle dans la sécurisation des
parcours.
3) Nouvelles formes d’entreprise, nouvelles formes d’organisation.
Le développement de l’économie sociale et solidaire, l’implantation des associations, des
sociétés coopératives et les développements des formes d’emploi qui leur sont liées témoignent d’une évolution significative des nouvelles formes « d’entreprendre ensemble
».
Le thème de la gouvernance d’entreprise a émergé dans l’agenda de la réflexion en sciences sociales en même
temps que se diffusait la logique « actionnariale ». Les errements dans la gestion des entreprises, dont Enron a été le symbole, y ont largement contribué et la crise de 2008 a encore renforcé
les interrogations sur la légitimité de la firme capitaliste classique.
Les innovations sont multiformes. On les
observe dans l’apparition de nouveaux statuts juridiques hybrides comme les « flexible purpose corporations » en Californie ou les multiples variantes internationales des « entreprises sociales
». Les organisations de l’ESS sont au centre de ce mouvement de diversification des formes d’entreprise et en premier lieu les coopératives.
Ces innovations se retrouvent au coeur des firmes capitalistes avec l’introduction de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
dans leurs valeurs essentielles ou les propositions d’une gouvernance ouverte à l’ensemble des parties prenantes, ou l’entrée des salariés dans les instances dirigeantes. Les évolutions qui
concernent les organisations collectives de travailleurs indépendants, ce qu’on retrouve dans les coopératives d’activité ou les espaces partagés de travail (coworking), articulées à l’appel à un
financement participatif (crowdfunding) sont apparentées à ces changements.
Les enjeux essentiels communs à ces
transformations institutionnelles concernent la démocratisation du pouvoir détenu par les dirigeants d’entreprise représentant les intérêts des seuls propriétaires, mais aussi la définition des
rémunérations et la répartition des surplus dégagés par les organisations productives.
Les travaux attendus sur ce
thème sont d’une part l’analyse critique de ces nouvelles formes organisationnelles ou ces nouveaux modes de gouvernance, d’autre part l’analyse de l’impact de ces nouvelles formes d’entreprendre
ensemble sur les pratiques en matière de salaire et de management, l’emploi, les relations inter-entreprises, le rapport à la clientèle, etc.
4) Nouvelles dynamiques institutionnelles, dialogue social et gouvernance.
Les objectifs de cohésion sociale dans une économie ouverte à l’innovation questionnent les
politiques publiques et bousculent les formes institutionnelles dans le champ social. Produire du changement social, sécuriser les mobilités suppose de mobiliser les institutions et de gérer
leurs transformations. La protection sociale est de plus en plus souvent considérée moins sous l’angle de son coût qui handicaperait la bonne marche de l’économie que dans la logique de
l’investissement social à long terme. Ces changements de perspective impliquent aussi de coordonner des interventions à plusieurs niveaux territoriaux, dans plusieurs champs de la protection
sociale, entre plusieurs catégories d’acteurs sociaux.
La production de règles et de normes nouvelles est largement
sollicitée. Cela impacte bien sûr le dialogue social et en particulier son échelon territorial. Cela se concrétise également dans la redéfinition de formes d’action publique et collective avec la
territorialisation des politiques publiques, le développement de relations multi-centrées et de formes partenariales de coordination entre les différents acteurs. Un meilleur appui sur la
participation des citoyens ou des bénéficiaires est recherché en vue d’une bonne prise en compte de leur situation et de leurs besoins. Ce mouvement touche tant les politiques d’emploi, que les
politiques d’éducation, les politiques de santé (cf. loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires) ou encore les politiques de la ville ou de développement durable (Agendas
21).
Dans le même temps, le New Public Management produit des innovations tant au niveau des organisations
publiques que des institutions. De nouveaux instruments de gestion de la performance sont introduits, des méthodes d’évaluation, d’allocation de ressources etc… Les relations centre-périphérie se
renouvellent aussi avec le développement d’un gouvernement par contractualisation et la mise en place de « quasi-marchés », le développement des agences et l’injonction à la
coopération.
Dans quelle mesure ces recompositions de l’action publique redéfinissent-elles de nouvelles normes et
de nouveaux cadres d’action ? Qu’attendre d’une systématisation de la contractualisation et de la mise en réseau entre acteurs intervenant sur un territoire ? Peut-on définir des pratiques
pertinentes dans ce domaine ?
La question de la gouvernance au sens de coordination entre acteurs est posée, mais
aussi celle du contrôle des processus de changement social. Il s’agit d’étudier la question du fonctionnement des économies en lien avec les objectifs collectifs et sociaux vers lesquels la
société souhaiterait orienter les actions des acteurs, les dispositifs publics d’incitation, d’évaluation et de contrôle.
De nombreuses recherches portent directement ou implicitement sur ces questionnements depuis 2008, sur le thème de contrôle social ou de
la réglementation des activités économiques pour une société plus juste et équitable. On peut parler à ce sujet d’auto régulation en s’appuyant sur la société civile (en tenant le pouvoir public
centralisateur le plus possible à l’écart) alors d’autres approches argumentent pour une plus grande intervention des instances publiques ou collectives hors marché. La question de la dynamique
institutionnelle et des formes de gouvernance sociale se trouve au coeur de la problématique.
Cet axe est donc
ouvert aux communications portant sur les formes de gouvernance, de dialogue social notamment à l’échelle des territoires et aux nouvelles dynamiques institutionnelles liées à une intensification
de l’innovation.
5) Nouvelles méthodologies, concepts et mesures.
L’innovation est également épistémologique. Depuis le début des années 2000, on assiste à une
remise en cause des indicateurs monétaires de mesure de la richesse, comme le Produit Intérieur Brut, incitant à compter “ce qui compte” et non ce que l’on sait compter. Dans le même temps, la
réflexion sur les formes de la pauvreté et de la précarité conduit à dépasser une approche trop cantonnée aux manifestations monétaires, pour mieux prendre en compte l’ensemble des opportunités
et des capacités de réalisation réelles offertes aux personnes dans leur existence matérielle.
L’attention se porte
sur la richesse non monétaire. Elle dépend en grande partie des ressources qu’un individu peut mobiliser, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, du fait de son insertion dans divers
réseaux sociaux formels (appartenance à différents collectifs plus ou moins institutionnalisés) ou non formels (systèmes de sociabilité). Il s’agit donc d’évaluer le capital social, hérité ou
acquis, dans lequel un individu peut puiser des ressources matérielles et immatérielles (informations, soutiens, écoute, etc.) et plus largement d’interroger la notion de
bien-être.
Ces postures méthodologiques nouvelles, adoptées aux différents échelons de l’observation sociale (du
local à l’international en passant par le national) questionnent les démarches et les concepts à partir desquels les réalités socio-économiques sont mises en chiffre : qu’est-ce qu’on observe et
mesure ? A quelle échelle ? Comment analyser la fabrication des normes encadrant la mise en chiffres des réalités observées ainsi que leur éventuelle circulation spatio-temporelle ? Comment
saisir les rapports de pouvoir en jeu ?
Emerge alors une série d’interrogations liées à la finalité de la
construction d’indicateurs : s’agit-il de se conformer au réel ou de configurer des possibles ? Produire de la connaissance sur ce qui compte pour les citoyens et en informer les décideurs
politiques ou négocier de manière autoritaire l’insertion d’une économie (locale, régionale ou nationale) dans un ordre institué ? In fine, il s’agit de s’interroger sur la capacité des nouveaux
indicateurs socio-économiques à alimenter une gouvernance réflexive prenant en compte les dimensions essentielles structurant le vivre ensemble (des valeurs individuelles à l’imaginaire collectif
partagé).
Cet axe est donc ouvert aux communications qui portent sur les innovations méthodologiques dans les
travaux d’observation sociale liés aux constructions d’indicateurs alternatifs.
Si le Comité scientifique de l’AES attend avec intérêt les contributions relevant avant tout du
thème central du colloque, comme chaque année, les Journées de l’AES sont aussi ouvertes à des contributions relevant des divers champs habituels de l’économie sociale tels que la santé,
l’éducation, la protection sociale, le logement, l’économie du secteur non-marchand, la pauvreté et l’exclusion, l’économie de la culture. Des projets de communications non spécifiques au thème
central peuvent donc également être soumis à l’évaluation du Comité scientifique de l’AES.
Modalités pour répondre à l’appel à communications
Les projets de communications doivent être présentés selon le plan-type suivant (2 à 3 pages
maximum).
Sur la première page seront indiqués le titre de la communication, le ou les nom(s) d’auteur(s), les adresses postale et électronique de l’auteur (des auteurs) [en cas de
co-auteurs, souligner le nom du correspondant], l’organisme d’appartenance de l’auteur (des auteurs).
La proposition de communication abordera les points suivants :
– exposé bref de la problématique et de son enjeu ;
–
pour les communications entrant dans le thème principal du colloque, mentionnez le numéro du thème et l’articulation avec la problématique proposée ;
– l’originalité de la communication en la situant dans la littérature existante ;
– la nature de la communication : théorique, empirique ;
– la démarche méthodologique : sources et outils ;
–
l’état d’avancement du travail ;
– une bibliographie sélective (5 à 10 références).
Ces projets seront soumis exclusivement par voie électronique avant le 2 novembre 2013 sur le
site du Creg à l’adresse suivante (où vous trouverez également toutes les informations utiles ainsi qu’un lien pour contacter directement les organisateurs) : aes2014@upmf-grenoble.fr ; http://creg.upmf-grenoble.fr
Calendrier
Date limite de réception des projets de communication : 2 novembre 2013
Réponse du Comité scientifique aux auteurs : 20 décembre 2013.
Date limite de réception des textes définitifs pour publication dans les Actes : 18 avril 2014.
Publication des actes
Les différentes contributions retenues, qu’elles portent ou non sur le thème central, pourront
être publiées dans les Actes des Journées, à paraître aux Presses universitaires de Louvain. Le Comité scientifique sélectionnera en mai 2014 les meilleures communications. Sont éligibles à cette
publication les communications parvenues au plus tard le 30 avril 2014 et respectant les normes de présentation (normes qui seront communiquées à l’issue de la procédure de sélection des
projets). Les textes des communications non retenues pour publication dans les actes et les textes de communications parvenant au-delà de la date limite du 18 avril 2014 seront cependant
téléchargeables à partir du site du Creg.
La valorisation des publications pourra enfin se prolonger dans des
numéros spéciaux de revues à comité de lecture. Le comité d’organisation des journées est en contact avec les revues Formation Emploi et la série AB Socio-économie du travail de la revue
Economies et sociétés en vue de promouvoir la publication d’articles ou de réaliser des dossiers dans ces revues une fois les actes des journées publiés. Le comité local d’organisation s’engage à
engager les actions nécessaires pour qu’une partie des textes soumis soient valorisés de cette façon.
Comité d’organisation
CREG UPMF 1241 rue des résidences – B.P. 47 – 38400 Saint Martin d’Hères 0033 476 825435 http://creg.upmf-grenoble.fr
Laurence Baraldi ; Bernard Baudry ; Isabelle Borras ; Nathalie Bosse ; Christine Durieux ; Chantal Euzéby ; Valérie Fargeon ; Hervé
Charmettant ; Catherine Figuière ; Bruno Lamotte ; Anne Le Roy ; Cécile Massit ; Jean François Ponsot ;
Emmanuelle Puissant ; Yvan Renou ; Faruk Ulgen.
Conseil scientifique
Philippe Batifoulier (Université Paris-X Nanterre)
Cécile Bourreau-Dubois (Université de Lorraine)
Hervé Defalvard (Université Paris-Est et Chaire d’économie sociale et solidaire de
l’UPEMLV), Président de l’AÉS
Jean-Paul Domin (Université de Reims), Trésorier de l’AÉS
Claire El Moudden (Université de Caen)
Chantal Euzéby (Université Grenoble-II Pierre Mendès-France)
Maryse Gadreau (Université de Bourgogne)
Bruno Jeandidier (CNRS et Université de Lorraine)
Marie-Ève Joël (Université Paris-IX Dauphine)
Stéphanie Laguérodie (Université Paris-I)
Bruno Lamotte (Université Grenoble-II Pierre Mendès-France), Secrétaire général de l’AÉS
Guillemette de Larquier (Université Paris-X Nanterre)
François Legendre (Université Paris-Est Créteil)
Marthe Nyssens (Université catholique de Louvain)
Michel Maric (Université de Reims)
Jean-Luc Outin (CNRS et Université Paris-I)
Francesca Petrella (Aix-Marseille Université)
Jean-Michel Plassard (Université Toulouse-I Sciences sociales)
Delphine Remillon (Inéd)
Nadine Richez-Battesti (Aix-Marseille Université)