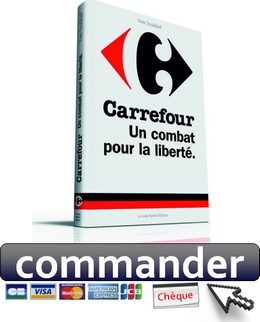UNIVERSITE PAUL CEZANNE
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
Les dossiers doivent être envoyés par courrier au Professeur J.-Y. NAUDET
Centre de Recherches en Ethique – Faculté de Droit et de Science Politique
3 avenue Robert Schuman – 13628 Aix-en-Provence cedex 1 – tél : 04 42 17 28 73
(Ne pas oublier d’indiquer vos coordonnées personnelles, téléphone, et adresse e.mail)
DU ETHIQUE ECONOMIQUE
ET DES AFFAIRES
Responsable : Jean-Yves
Naudet, Professeur d’économie à la Faculté de droit, Directeur du centre de recherches en éthique économique et des affaires.
Durée totale du DU : 90
heures DE COURS
Frais de formation :
Formation initiale : 350 € – Reprise d’études non
financée : 500 € –
Formation continue : 1000 €
Equilibre et ouverture du diplôme à 24 étudiants – Capacité maximale d’accueil : 50
Date limite de dépôt des candidatures : 6 septembre 2010
DU ouvert à tous les étudiants de L3 et de Master 1 et 2 de la Faculté de Droit et de la FEA, ou d’autres composantes de l’Université, comme diplôme complémentaire (second diplôme) ou à des professionnels (reprise d’études non financée ou formation continue). Dans tous les cas, recrutement sur dossier. En formation initiale : relevé de
notes et lettre de motivation ; pour les professionnels : CV et lettre de motivation.
Cours : Deux ou trois soirs par
semaine (pour un cours de 2 ou 3 heures) à 18 h 00 (cours de septembre à avril).
Contrôle des connaissances : Un seul examen synthétique par module, en mai-juin (coefficient 1 par module), module 1 à l’oral, modules 2,3, 4 avec des écrits de 2 heures chaque, compensation entre les modules, pas de seconde session, redoublement autorisé sur décision du Directeur, mentions :
passable (10), assez-bien (12), bien (14), très bien (16).
Moyens : Le DU bénéficie
des moyens du Centre de Recherches en Ethique Economique et, en particulier, de son réseau et de sa bibliothèque (1600 livres et de nombreuses revues consacrés à l’éthique). Les étudiants peuvent
aussi participer au colloque annuel d’éthique économique organisé par le Centre.
Exposé des motifs :
La question de l’éthique économique et des affaires se pose à tous les niveaux de l’activité professionnelle, que ce soit dans les entreprises,
les associations ou les administrations. Aucun étudiant sortant de l’université ne doit ignorer cette réalité.
Les conflits d’ordre éthique sont permanents dans les organisations publiques ou privées entre les diverses parties prenantes : en
comprendre les raisons, savoir discerner les enjeux et les motifs, envisager des solutions, fait déjà partie du travail des cadres privés ou publics.
Dans toutes les organisations, se mettent en place des chartes éthiques, des codes de conduite, des politiques de développement durable, des
comités d’éthique, etc. Il faut donc en comprendre le langage et connaitre les enjeux en cause, a fortiori pour participer à leur mise en place.
En outre, dans tous les concours administratifs, dans les recrutements de toute nature, le questionnement des candidats sur les sujets éthiques
est permanent. Cela fait aussi partie de la culture générale, qui joue un rôle dans tout recrutement.
Enfin, au moment où il est question de moralisation du capitalisme, les étudiants doivent trouver dans l’université une formation complémentaire
à leur formation principale, leur permettant de comprendre l’importance de ce débat et d’en tirer les applications pratiques pour leur vie professionnelle.
Dans le monde économique de demain, l’éthique sera non seulement un outil de gestion intégré dans les outils du management, mais encore un
élément décisif dans le choix des cadres du secteur privé ou public. L’économie de marché a besoin d‘acteurs formés aux questions éthiques. Il existe une forte demande de la part des chefs
d’entreprises pour recruter des diplômés en droit, ou en économie, ayant par ailleurs des connaissances en éthique économique et des affaires. C’est un « plus » indiscutable pour un
recrutement
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
MODULE I : Les principes généraux de l’éthique économique (16
heures)
(Coefficient 1, un examen oral unique)
–
L’éthique : mode ou nécessité ; la responsabilité sociale de l’entreprise ; la moralisation du capitalisme (9 h 00)
– L’éthique dans l’histoire de la pensée économique (4 h
30)
– Analyse économique et jugements de valeurs (2 h
30)
MODULE II : Les fondements de l’éthique économique (22
heures)
(Coefficient 1, un examen écrit unique de 2 heures)
– Les fondements philosophiques de l’éthique (10 h
00)
– Religions et éthique économique (12 h 00 en tout)
. L’éthique sociale chrétienne (4 h 00)
. Le judaïsme et l’éthique économique (4 h 00)
. Ethique économique et financière dans l’Islam (4 h 00)
MODULE III : Droit et éthique économique (26
heures)
(Coefficient 1, un examen écrit unique de 2 heures)
– L’éthique consubstantielle au droit (4 h 00)
– Ethique et droit des affaires (6 h 00)
– Ethique et lex mercatoria (2 heures)
– Responsabilité sociale de
l’entreprise : le point de vue juridique (2 h 30)
– Regard juridique sur l’éthique financière (3 h
00)
– Ethique, droit et propriété (2 h 00)
– Ethique et propriété intellectuelle (2 h 00)
– L’éthique du dirigeant de société (2 h 30)
– Ethique et droit international du développement (2 h
00)
MODULE IV : Ethique économique appliquée (26
heures)
(Coefficient 1, un examen écrit unique de 2 heures)
– L’éthique financière (2 h 00)
– Ethique et déontologie des médias (2 h 00)
– Ethique et nouveaux médias (2 h 00)
– Les chartes éthiques (2 h 00)
– Ethique, environnement et développement durable (3 h
00)
– L’éthique de l’entrepreneur (2 h 00)
– Ethique et syndicalisme (2 h 00)
– L’éthique des échanges et le commerce équitable (2 h
00)
– Ethique, économie et propriété (2 h 00)
– L’éthique, outil de gestion (2 h 00)
– Analyse économique de la corruption (2 h 00)
– Le mécénat, outil d’une économie éthique (3 h 00)